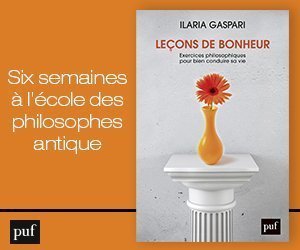Le congrès de Tours, une « épuration » qui a durablement marqué la gauche française
Les dirigeants bolchéviques, après avoir vaincu le gros des forces armées des Blancs et s’être lancés dans l’invasion de la Pologne, organisèrent du 17 juillet au 7 août 1920 le IIe congrès de l’Internationale communiste (IC) dans un esprit offensif. En tête Lénine, qui avait exigé une nouvelle Internationale dès août 1914. La stratégie de l’IC, supervisée par lui et présidée par un de ses proches, Zinoviev, était de soutenir de nouveaux partis qui lutteraient pour la révolution communiste et de scinder les anciens partis socialistes qualifiés de « social-chauvins » en raison de leur attitude face à la guerre. L’IC voulait des partis bolchévisés regroupés dans une organisation qui imiterait elle-même le parti bolchévique russe et dirigée par ce parti.
Lénine rédigea dans cet esprit les conditions impératives d’adhésion à l’IC[1], qui, assez peu modifiées, furent adoptées au IIe congrès et furent au nombre de vingt-et-une. Les conditions appliquaient la doctrine léniniste de l’organisation selon laquelle il valait mieux un petit nombre de militants soudés dans l’« unité de la volonté » qu’un parti divisé en tendances concurrentes. Le cœur de cette technologie avait été inscrit en exergue à Que faire ? en 1902 : « le parti se renforce en s’épurant ». Ce principe fut amplifié par la prise du pouvoir et appliqué au parti mais aussi à l’État, à l’armée, à l’industrie, à la société entière. Lénine et l’IC l’imposèrent aux partis communistes : aussi l’impératif pour les révolutionnaires français fut-il de se débarrasser des « traîtres », à savoir des socialistes réticents au bolchévisme. Et ainsi, le congrès de Tours du Parti socialiste en décembre 1920 ne fut pas, dans la logique de l’IC, une scission mais une « épuration[2] ».
Lénine précise que la dictature du prolétariat ne lutte pas seulement contre la bourgeoisie, mais aussi contre les éléments arriérés du prolétariat et contre les réformistes, qu’il faudra « fusiller ».
En furent spécialement victimes Jea