Comment j’ai appris quelques langues « étrangères » – le français (2/2)
Quelques temps plus tard, alors que je séjournais à Paris, je suis tombé sur un ancien étudiant qui était devenu lui-même professeur : Malcolm Spector, qui, diplôme de doctorat de Northwestern sous le bras, était parti enseigner au Canada, à l’Université McGill, dans la ville bilingue de Montréal. Contrairement à la quasi-totalité des professeurs anglophones de cette université, il avait appris le français et était donc devenu bilingue. Quand je lui ai dit que j’avais commencé un livre sur la sociologie de l’art (publié plus tard sous le titre Art Worlds, et Les Mondes de l’art en français), il m’a conseillé la lecture d’un ouvrage mais en me précisant qu’il fallait apprendre à lire le français si je voulais le lire. N’acceptant ni mes justifications ni mes tergiversations, il a continué à me tanner pour que je lise ce livre. Alors, j’ai fini par acheter Le Marché de la peinture en France de Raymonde Moulin et, en parcourant la table des matières (comprenant suffisamment de cognats avec l’anglais), j’ai tout de suite su que Spector avait raison : sa lecture s’imposait.
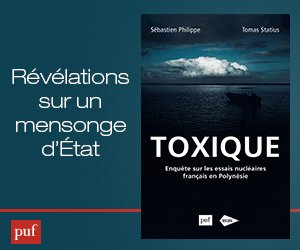
Ce livre a comblé un vide dans ma réflexion – la nature des arrangements économiques dans le domaine des arts – et promettait d’être utile à bien des égards. Mes recherches pour mon propre livre m’avaient déjà convaincu que l’une des principales choses qui manquaient à la sociologie de l’art, sous sa forme d’alors, était la prise en compte de ce que les spécialistes de la peinture, de la musique et d’autres domaines artistiques avaient à dire sur ces sujets. Et il m’avait également convaincu que je gagnerais beaucoup à ignorer les frontières disciplinaires (ou, désormais, les barrières linguistiques).
Donc, oui, je devais le lire, mais je ne savais pas lire le français. Mon expérience au Brésil, cependant, m’avait appris que ce problème n’était pas aussi insurmontable que je le pensais (et que continuent de le penser à peu près tous mes collègues américains), et encore moins dans le cas prés
