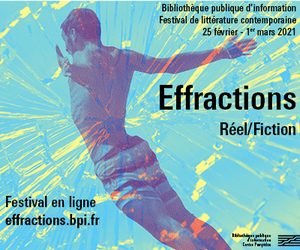Variations sur l’amour – sur le cycle Arte Emmanuel Mouret et Les Choses qu’on dit, les Choses qu’on fait
Sur arte.tv, depuis mi-décembre et jusqu’à mi-juin une rétrospective permet de voir cinq films d’Emmanuel Mouret, réalisateur d’origine marseillaise qui s’est formé à la Femis. Sort en même temps, ces jours-ci, son dernier film en DVD. Admettons-le en préambule : on ne peut s’empêcher de penser que le cinéma de Mouret a quelque chose de bourgeois, du moins exhale-t-il un parfum bourgeois, tant sur le plan scénaristique (il ne cherche jamais à attaquer l’ordre social ou à le bousculer) que stylistique (l’écriture filmique demeure assez « sage », rien de bien « punk » n’affleure). Thématiser le désir et les sentiments, cela ne rime pas forcément avec l’évacuation du monde social, de ses configurations et de ses obstacles.
Mouret l’assume, en tout cas, qui déclare ne pas goûter au naturalisme et au réalisme social, celui qui, comme il le dit, privilégie la caméra à l’épaule et le gros plan. Dans l’ouvrage Entretiens d’un rêveur en cinéaste de Maryline Alligier, il énonce clairement cette tendance à travers l’un de ses modèles ou « pères » de cinéma (selon ses mots) : « Woody Allen a dit qu’il n’aimait pas trop la drogue, que le soir il aimait bien se coucher pas trop tard et qu’il aimait bien manger, ce qui l’amenait à conclure qu’il devait être certainement un cinéaste bourgeois. » (p. 148). Mais on aurait tort pour autant de se priver de la compagnie de ses films (de certains d’entre eux du moins) ; Woody Allen, de pratiquer un cinéma qui n’est pas contestataire ou subversif, n’en est-il pas moins l’auteur de chefs d’œuvre absolus comme Annie Hall ou Match Point ?
Deuxième long-métrage de Mouret après Laissons Lucie faire ! (2000), Vénus et Fleur (2004) est déjà l’un de ses plus réussis, en tout cas l’un de ses plus vivifiants. À Marseille, une jeune fille, Fleur, accueille dans la maison de famille dont elle dispose pour les vacances une jeune femme prénommée Vénus, venue de Russie. La pétulance et la spontanéité de cette dernière tranchent avec le caract