Gérer la population mondiale : urgence ou illusion ?
Si la planète a besoin d’être à tout prix « sauvée », s’il y a urgence à agir, quelle est la plus grande menace ? Est-ce notre nombre ou la façon dont nous vivons ? Ou les deux ? Et le progrès dans tout cela, comment intervient-il ? Apporte-t-il vraiment plus de solutions qu’il ne crée de problèmes ?
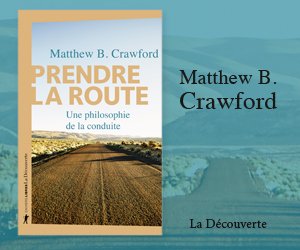
Lorsqu’il est question des relations entre dynamiques démographiques et changement environnemental en général ou changement climatique en particulier, certains sont tentés de mettre en accusation le facteur population comme principal responsable de la dégradation de l’environnement. La solution paraît alors bien simple. Il suffit de renforcer les politiques démographiques pour faire baisser la fécondité plus rapidement qu’actuellement et ralentir – voire stabiliser – la population mondiale au plus vite.
Mais-est-ce si facile de modifier les comportements reproductifs ? L’Inde a mis en place ses premiers programmes de planification familiale au début des années 1950 et a dû par la suite réviser ses objectifs à de multiples reprises, la natalité effective restant toujours bien supérieure à celle souhaitée par les autorités du pays.
De plus, il ne suffit pas que la fécondité baisse substantiellement pour enrayer la croissance démographique : si la fécondité mondiale se situait du jour au lendemain au niveau du remplacement des générations (légèrement supérieur à deux enfants par femme), la population mondiale continuerait de croître pendant plusieurs décennies du fait de l’élan acquis. La structure par âge de la population mondiale étant jeune, même si les couples n’ont en moyenne guère plus de deux enfants, le nombre total d’enfants reste très élevé et la population poursuit sa croissance.
On est parfaitement en droit de considérer qu’un objectif de stabilisation de la population mondiale est insuffisant et de préférer militer pour une décroissance de la population. En dehors du fait que les moyens d’y parvenir d’une manière volontariste manquent – efficacité tr
