État d’urgence, moment démocratique
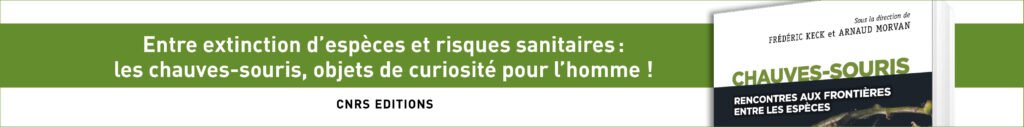
L’état d’urgence, parce qu’il pose crûment la question des exceptions aux règles publiques ordinaires, est notoirement difficile à appréhender. À l’heure de la défiance et de l’exaspération générales, l’effort n’en est pourtant que plus nécessaire. Il pourrait répondre, en outre, au sentiment confus que nous sommes peut-être à un instant décisif, qu’il nous appartient de saisir, et dont nous nous demandons (ce qui est sans doute, précisément, le propre de l’urgence) s’il n’est pas déjà trop tard pour l’avoir saisi.
Mais pour ce faire il faut se garder de deux confusions symétriques, l’une qui rabat l’urgence sur le tempo économique de l’accélération, l’autre qui l’absolutise en la renvoyant à des autorités transcendantes. Cependant, appréhender la portée démocratique de l’urgence doit plutôt conduire à redéfinir les contours de la communauté politique.
Urgence versus accélération
Il y a bien sûr un paradoxe un peu provocateur à émettre l’idée que l’état d’urgence sanitaire, qu’on sait si défavorable aux libertés publiques, puisse constituer un moment démocratique. Or de fait, la formule « état d’urgence sanitaire » a de quoi désorienter, ne serait-ce que parce que le confinement qu’il a servi à déclencher a d’abord constitué un gigantesque ralentissement de nos activités. En outre, loin d’avoir été vécu comme une grande pause, ce confinement a suscité une fébrilité inouïe, à tous les niveaux de la société, comme de la part des responsables politiques et administratifs. Et enfin, si la confusion mentale n’était pas déjà à son comble, elle a encore été aggravée par le déni, toujours persistant, de la gravité de la situation.
S’il est difficile de définir l’urgence en général, c’est aussi que celle-ci n’est pas dans les choses, mais dans le regard que nous posons sur elles. Dire que des mesures d’urgence doivent être prises pour limiter le réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité, ce n’est pas dire que ce sont le Tétras lyre ou l’atmosphère qu
