Freak show – à propos d’Annette de Leos Carax
Sur Annette, tout semble déjà avoir été dit, puisqu’il s’agit d’un film-événement à divers titres : retour de Carax, reprise de Cannes et de la vie cinéphile d’avant, film d’ouverture, rampe de lancement du festival et du redécollage espéré du cinéma en salles, projet ambitieux plusieurs fois avorté puis rebooté dont les gazettes parlaient depuis des années, casting de stars internationales… Tout cela semble avoir cristallisé une sorte d’enthousiasme obligatoire et quasi-unanime : peu de réserves dans la presse, hormis celles, prévisibles, ricanantes et jouées d’avance d’Éric Neuhoff dans Le Figaro.
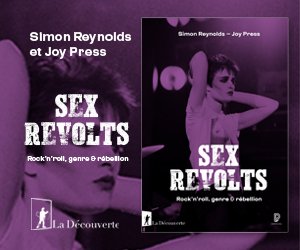
La bulle cannoise étant soumise à une temporalité et une vitesse qui n’ont rien de commun avec celles du monde normal (fut-il lui aussi numérisé), Annette est déjà de l’histoire ancienne pour l’espace-temps de la Croisette (il y a deux jours ? il y a donc un siècle), remplacée par les films qui se succèdent et effacent les précédents quotidiennement, voire heure par heure : déjà Lapid, Ozon, Carrère, Harari… bientôt Ducournau, Moretti, Audiard, Weerasethakul, ou le premier film pépite qui enflammera Twitter dès la sortie de projo (ou même pendant). Ainsi va Cannes…
J’écris ce texte à Paris et ici, dans le monde normal, Annette est encore tout frais dans sa première semaine d’exploitation, même pas encore dans son premier week-end. À l’heure de ces lignes, le public semble mordre tièdement : le film est certes deuxième au classement de la première séance derrière Black Widow, mais avec une moyenne de spectateurs très… moyenne. Sans préjuger de la carrière d’Annette au box-office, on peut au moins déjà dire que son succès ne sera pas à hauteur de l’évènement médiatique et critique annoncé.
Une fois liquidée cette question qui concerne surtout les distributeurs et les amateurs de statistiques, qu’en est-il du film, le seul enjeu qui nous occupe ici ? Il est décevant et passionnant. Passionnant parce que décevant. Et parce qu’il s’agit de Leos Carax, cinéaste rare
