La justice des mineurs, au risque du paternalisme ?
Il n’est pas rare d’entendre dire que la justice des mineurs est constamment réformée : en témoigneraient les multiples réformes de l’Ordonnance du 2 février 1945 qui la fonde dans son aspect contemporain, c’est-à-dire en tant que justice spécialisée, construite autour de la figure centrale du juge des enfants. Certes, l’Ordonnance fondatrice va prochainement disparaître pour laisser place à un « Code de la justice pénale des mineurs » promu en son temps par la droite sarkozyste, certes le vocabulaire des gouvernements successifs depuis 2002 et sa campagne présidentielle sur le thème de l’insécurité s’est radicalisé (voir Gérald Darmanin et son usage de la notion d’« ensauvagement de la société », au cœur de la rhétorique identitaire d’extrême droite depuis plusieurs années), mais, dans le même temps, les tribunaux pour enfants demeurent, ainsi que la volonté de toujours faire primer « l’éducatif » sur le « répressif ».
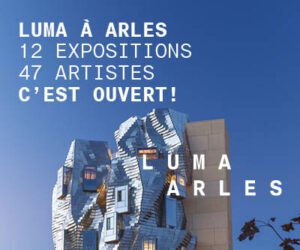
Les représentations collectives de la justice des mineurs témoignent des évolutions du regard porté dans la société sur les déviances adolescentes. Les historiens Myriam Tsikounas et Sebastien Lepajolec décrivent par exemple comment le cinéma a raconté, dans la seconde moitié du XXe siècle, l’évolution de la relation entre jeunes et institutions de contrôle : si les années 1950/60 décrivent la prise en charge institutionnelle des jeunes au tribunal, l’omnipotence du juge et des institutions de rééducation, les années 1990 décrivent bien davantage le rapport des jeunes à la police.
Trois films suffiraient d’ailleurs à se convaincre du gap dans les représentations, entre le « bon juge » et l’institution des années 1950 décrits par les films Chiens perdus sans collier (1955, réalisé par Jean Delannoy sur la base d’un ouvrage de Gilbert Cesbron) ou Les quatre cent coups de François Truffaut (1959), et le quartier populaire marqué par la violence du rapport entre jeunes et police de La haine de Mathieu Kassovitz (1995). Cette évolution des repr
