Qu’appelons-nous « travail » ?
«Je présenterai à la rentrée le “revenu d’engagement” pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoirs et de droits», a annoncé Emmanuel Macron dans son allocution du lundi 12 juillet 2021.
Ainsi, et dans la droite ligne des politiques publiques depuis quarante ans, l’État entend proposer à des « jeunes » qui subissent le chômage, de réaliser des activités « engageantes » et productives, dans un cadre institutionnel contraignant, mais hors emploi.
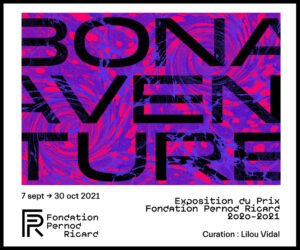
Cette mesure vient abonder les nombreux dispositifs aux marges du droit du salariat, qui entendent soulager la tension sociale autour du chômage. Ils résultent de l’hypocrisie de la norme salariale : dans notre société, l’emploi est une norme centrale. Le « travail » est réputé être ce qui permet à un citoyen ou une citoyenne d’être « insérée ». Sans emploi, pas de revenu, pas de logement, pas « d’autonomie » ni d’identité sociale positive qui permettrait de répondre sans douleur à la question « et toi, tu fais quoi dans la vie ? ».
Cette norme impose d’organiser nos existences pour l’emploi – ou, plus compliqué de vivre sans lui. Or, nous le savons : il manque de plus en plus, et ce massivement, depuis quarante ans.
Face au chômage de masse chronique, la solidarité et l’assistance permettent d’atténuer la pauvreté, mais en partie seulement. Au nom de la valeur « travail » court aussi avec constance depuis des siècles une critique de « l’assistanat ». Alors les politiques publiques, loin de résoudre la contradiction entre norme et réalité, bricolent des ponts entre eux, pour les personnes dites « éloignées de l’emploi » – jeunes, plus de 50 ans, handicapés, prisonniers, sans domicile… – qui renforcent la norme d’emploi comme d’effort méritant.
Elles obligent ainsi les bénéficiaires de minima sociaux à réaliser des tâches précises, supposées les aider à trouver un emploi, et prouver leur volonté d’y arriver, d’une part ; d’autre part, elles incitent finan
