Le drôle de Docteur Djian – sur Double Nelson de Philippe Djian
Il y a bien un médecin, prénommé Georges, dans le nouveau roman de Philippe Djian, qui emprunte assez drôlement son titre à une prise de catch : Double Nelson. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’on aura eu envie ici de parler du « Docteur Djian » : plutôt pour s’amuser de l’espèce de coïncidence qui fait des initiales de l’écrivain l’acronyme anglo-saxon du titulaire d’un doctorat – PhD, pour « philosophiae doctor ».
Philippe Djian n’a pas soutenu de thèse à universitaire, à notre connaissance, mais il a sur la littérature des idées, des principes, une sorte de corpus informel de conceptions qui en font un drôle de docteur et savant original, lequel fait paraître à un rythme quasi-annuel des romans comme autant de publications scientifiques… On peut y lire, en tout cas, le résultat d’expériences d’écriture parfois presque loufoques et toujours passionnantes.
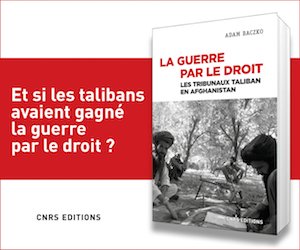
Voici donc Double Nelson, dont on pourrait dire a priori qu’il s’inscrit dans une veine mineure, voire néo-scénaristique (on sait que Oh… a donné lieu à Elle de Paul Verhoeven, par exemple, et on se souvient, outre le trop fameux 37°2, des adaptations de Téchiné ou des frères Larrieu ; on connaît moins, en revanche, les relations de Djian avec Maurice Pialat, juste avant sa mort, sur un projet qui demeurera donc une source de rêverie…). Qu’importe : ce nouveau récit assez bref, centré comme presque toujours sur une affaire de couple, se lit à nouveau comme une captivante variation expérimentale où l’auteur – c’est chez lui une constante – s’emploie d’abord à s’amuser.
Il faudrait en effet commencer par là : cet écrivain volontiers raillé pour des audaces métaphoriques où certains ont vu des incohérences, mais dont le style, autrefois étudié par le grand Jean-Pierre Richard (dans L’État des choses, étude sur huit écrivains d’aujourd’hui, Gallimard, 1990), a évolué vers plus de sobriété elliptique, est d’abord un singulier blagueur.
Ce n’est pas si simple, à vrai dire, de définir l’ironie de notre bo
