De père en fils, la violence immuable – sur Le fils de l’homme de Jean-Baptiste Del Amo
Parmi tous les pères dont cette rentrée littéraire brosse le portrait, en voici un qui est particulièrement brutal et par bien des aspects, universel. Malgré tous ses défauts, le lecteur reconnaît chez cet homme quelques invariants des pères : une façon de se mouvoir, d’exercer son autorité, d’entraîner chez l’enfant un désir de protection et l’espoir de regarder le monde juché sur ses épaules.
Jean-Baptiste Del Amo sait faire naître ces envies grâce à son art de la description des attitudes et des gestes furtifs : un saut par-dessus une rambarde, un bras nonchalamment posé sur une barre en acier suffisent à rendre l’enfant béat devant le père.
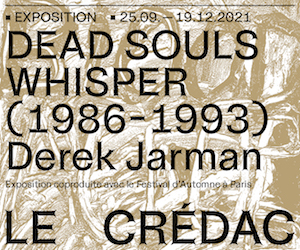
Cinquième roman de cet écrivain de 39 ans, Le Fils de l’homme désigne à la fois un père, et un enfant. C’est l’histoire d’une violence transmise, répétée, qui se reproduira peut-être sur plusieurs générations. Aussi âpre que Règne animal (Gallimard, 2016), le précédent roman de Jean-Baptiste Del Amo qui dessinait déjà une généalogie, Le Fils de l’homme s’inscrit à la fois dans le genre du récit mythologique et dans le présent. Jean-Baptiste Del Amo présente un milieu, une misère, mais il le fait en passant. L’écrivain dont le style est austère ne s’attarde sur rien.
Le Fils de l’homme est une tragédie, un thriller, à la manière de Faulkner. Un homme revient de force dans la vie d’une femme avec laquelle il a eu un fils âgé désormais de neuf ans. Le revenant exige que le duo mère-enfant quitte la ville (jamais nommée) et le suive aux « Roches », une maison abandonnée située dans la montagne.
Les « Roches » : ce nom annonce une chute et des blessures, des fractures ouvertes. Le père lui-même a vécu aux Roches avec son père. On apprend que, dévasté par la mort de son épouse, ce père, le père de l’homme, donc, est devenu fou et dangereux pour son fils qui a fui les lieux à quinze ans. En filant il a sauvé sa peau. Il s’est installé dans la ville où il a rencontré « la mère ». Ils se sont amusés avec une « bande » d’amis
