Malaise dans la laïcité
Cette précampagne électorale confirme le glissement à droite et à l’extrême droite des représentations de la laïcité. Il ne s’agit pas seulement du tapage médiatique autour d’Éric Zemmour, des surenchères auxquelles se livrent les candidats à la candidature LR, mais également d’un climat général où les accusations de « wokisme » et d’« islamo-gauchisme » suffisent à stopper toute réflexion un peu libre.
Pour un historien, cette situation est d’autant plus frappante que, on le sait, pendant un bon siècle, la laïcité constituait un des marqueurs essentiels de la gauche. Or celle-ci semble à la dérive, incapable d’opposer une vision construite de la laïcité structurellement divergente du « à droite toute » actuel.
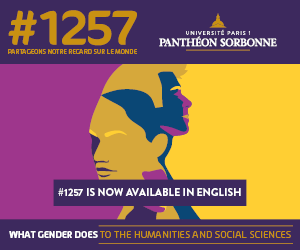
On peut, d’ailleurs, émettre l’hypothèse qu’il s’agit là d’une des raisons de sa faiblesse. Plusieurs de ses candidats déclarés ratifient, de fait, certains fondamentaux d’une laïcité de droite, quitte à tenter de leur enlever (tâche impossible !) ses aspects discriminatoires. Il faut dire qu’ils se heurtent à des commentateurs politiques, y compris sur les chaines du service public, qui présentent comme neutre, objective, la conception dominante de la laïcité. Ce discours mainstream fonctionne selon un schéma universalisme-laïcité-République qui parait imparable, mais où s’impose, en fait, comme évidence socio-politique, une conception droitière de chacun de ces items. Je voudrais donner ici quelques éléments de réflexion soumettant au débat ces représentations sociales.
Universalisme, sécularisation et figure de l’hérétique
Avec Hegel, et beaucoup d’autres, la philosophie occidentale a forgé un grand récit où modernité et sécularisation (conçue comme une perte d’influence, de pertinence culturelle, une marginalisation de la religion dans le vie sociale) constituaient les des deux faces d’un processus porteur d’un universalisme normatif[1]. Lors du troisième quart du 20e siècle, des sociologues de la connaissance et de la religion, tels Peter Berge
