Dé-chiffrer les politiques publiques
De façon sporadique mais régulière, les professionnels de service public expriment leur colère et leur désarroi en se mobilisant pour dénoncer le manque de ressources qui leur sont allouées pour accomplir leur mission.
Les dernières mobilisations en date sont les manifestations des personnels hospitaliers et la pétition signée à ce jour par plus de 7 000 magistrats. Avant elles, enseignants, psychiatres, policiers, pompiers, directeurs d’école ou agents pénitentiaires avaient occupé la rue pour faire connaître le délabrement de leurs conditions de travail. Et une même revendication est portée par ces professionnels : mettre fin à ces directives qui les obligent à « faire du chiffre ».
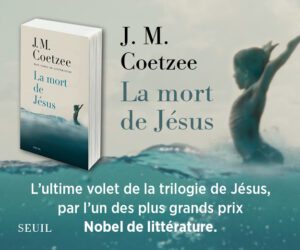
Les raisons de cette irritation viennent de loin. Depuis le début des années 1980, et en dépit des alternances politiques, les pouvoirs publics mènent, en France comme ailleurs dans les pays développés, une entreprise tenace de « démantèlement de l’État démocratique[1] » qui se mène à coup d’allègement d’impôts, d’austérité budgétaire, de réduction du nombre de fonctionnaires et de recours à la privatisation et à l’externalisation des services.
Cette entreprise a souvent été présentée comme la substitution d’une vision purement comptable de l’action de l’État à une conception politique de son engagement à assurer les conditions de l’égalité des citoyens. Et il est vrai que les gouvernements ont conduit cette « modernisation » de l’action publique en invoquant l’impérieuse nécessité de résorber la dette et de favoriser la liberté d’entreprendre.
Les revendications des professionnels de service public ciblent pourtant un tout autre phénomène : la mise en place d’un modèle gestionnaire d’exercice du pouvoir qui permet aux dirigeants d’expliquer leurs décisions en s’adossant à des données de quantification, au nom desquelles ils fixent des objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée à l’aide d’indicateurs de performance[2]. Ce changement de méthode de gouvernement se résum
