Perruques et papillotes : percer le mystérieux succès des Shtisel
Regarder Netflix déçoit souvent. Mais observer son évolution est passionnant. Un jour on croit saisir une stratégie éditoriale, celle régie par une pensée inclusive ouverte aux questions de genre et au progressisme sociétal – le parangon serait la série britannique Sex Education, manuel vaguement narratif de sexualité bon teint en milieu bourgeois – dont la troisième saison est diffusée depuis la mi-septembre. Et voilà qu’en une sortie impromptue, la plateforme parvient à nous surprendre.
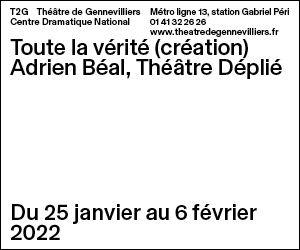
Ainsi d’une série débarquée en mars dernier qui m’a rapidement été proposée dans le bandeau principal, celui sur lequel défile une bande annonce destinée à attirer le chaland en fonction des ses choix précédents, mais aussi des grands succès d’audience du moment. Des hommes et des femmes en noir, papillottes et perruques, discutent sur un ton égal en yiddish dans des intérieurs mornes et spartiates : l’argument paraît mince, mais la curiosité est piquée. Me voilà plongée presque malgré moi chez les Shtisel, une série écrite par Ori Elon et Yehonatan Indursky, diffusée avec succès en Israël en 2013 à la télévision, et dont Netflix a flairé la bonne fortune.
Des ultrareligieux mis en scène dans la banalité de leur existence fruste et étriquée ? D’ordinaire, on aurait passé son chemin.
Soit une famille qui vit selon la tradition haredim dans le quartier de Geoulah à Jérusalem, une communauté juive ultraorthodoxe, dont les pratiques sont documentées au gré d’intrigues typiques du soap. Shulem Shtisel en est le patriarche ; veuf et inquiet de son déclin, il vit en compagnie de son fils Akiva, jeune homme sentimental et immature qui tarde à quitter le nid, tandis que sa fille aînée Giti, pieuse et abandonnée par son mari, se démène pour élever seule et sans ressources ses quatre enfants.
Alternent au gré de trois saisons des intrigues familiales et sentimentales dans un décor fermé et hors du temps, rythmé par les rites religieux qui imprègnent toute la vie courante, depuis les
