Appel des 3 000 juges : une émotion collective et objective
Les motifs des manifestations récentes des gens de justice sont multiples et portent principalement sur les moyens. Toutefois, dans l’appel des 3 000 juges[1] (devenus plus de 7 000 en quelques jours), il est aussi fait référence à des contraintes psychologiques. Il ne faut pas oublier que cet appel lui-même a été déclenché par le suicide d’un magistrat.
Or, la numérisation et le management judiciaire président au développement de la justice française. La recherche d’efficacité « industrielle » l’emporte sur l’artisanat des juges et des greffiers. Le management judiciaire peut certainement avoir du bon lorsqu’il réduit les coûts et les délais, mais il ne doit pas non plus décourager les juges écartelés entre des injonctions quantitatives et la volonté de bien faire comme l’a révélé l’appel des 3 000.
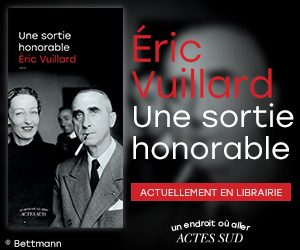
Les juges qui deviennent tendus dans leur exercice ne doivent pas être renvoyés par le président de la juridiction à leur difficulté personnelle (comme des témoignages de juges nous l’ont confirmé lors d’un séminaire à l’École nationale de la Magistrature [ENM] en novembre 2021). Les rapports processuels entre juges et parties constituent des cadres qui canalisent des émotions influant, avec le raisonnement judiciaire, sur l’application des règles de droit.
Partout en Occident, depuis deux siècles environ, s’est imposé le mythe du juge qui rend un jugement à distance de ses émotions[2]. Cependant, à la fin du XIXe siècle, en Allemagne, un débat a porté sur les émotions du juge dans le but de fabriquer un magistrat, homme et bourgeois, ayant une certaine culture de l’émotion[3]. Plus récemment, les neurosciences notamment nous ont fait comprendre que la raison et l’émotion étaient indissociables dans un processus décisionnel.
L’importance des émotions a maintenant été reconnue dans la justice alors que traditionnellement, les juges étaient invités à s’endurcir et à se tenir à distance de leurs émotions. Ce thème a également trouvé sa place dans la formation des
