L’intelligence artificielle, en peine pour traiter les mots de la justice
Il semble qu’à l’ère de la startup-nation, les ministères, même régaliens, ont vocation à traverser les turbulences que l’on aurait cru réservées aux ingénieurs-entrepreneurs de la Silicon Valley. En deux années d’expérimentation l’algorithme « DataJust », issu de l’initiative du ministère de la Justice avec l’appui d’enthousiastes entrepreneurs d’intérêt général, a suscité à la fois de grands espoirs et des craintes substantielles, a été attaqué de toutes parts dans ses fondements juridiques (et son opportunité) puis sauvé dans une décision du Conseil d’État, avant d’être en passe d’être abandonné face aux moyens nécessaires pour tenter d’en expurger les potentiels biais[1]. Un nouvel épisode qui confortera les habituels contempteurs d’une informatique judiciaire[2] qui a pourtant eu ses heures de gloire au début de l’informatisation des services de l’État dans les années 1980 et 1990[3].
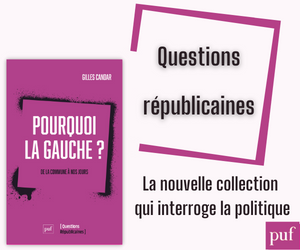
Rappelons qu’un décret du 27 mars 2020, paru en plein milieu du premier confinement de la pandémie de Covid-19, est venu créer « DataJust » avec l’objectif d’expérimenter les capacités de l’intelligence artificielle (« IA[4] ») pour améliorer la prévisibilité des décisions rendues par les tribunaux en matière de réparation du préjudice corporel. Il faut dire que ce contentieux, qui réserve au juge une très grande marge d’appréciation au titre de l’individualisation de la réparation, fait peser un très fort aléa sur les débiteurs de créance d’indemnisation – qu’il s’agisse de personnes physiques ou d’organismes payeurs privés ou publics.
En 2008, une tentative pour inscrire dans une loi un barème national avait échoué, malgré un livre blanc de l’Association française de l’assurance particulièrement argumenté. Des échelles indemnitaires établies par la Cour de cassation, comme la nomenclature « Dintilhac » ou le référentiel « Mornet », continuent donc encore aujourd’hui de servir de guide informel aux acteurs de l’indemnisation du dommage corporel afin d’assurer une meille
