Comment les frustrations sociales s’expriment en démocratie
Depuis le début de la pandémie, avec la succession de confinements et des mesures restrictives de liberté qui l’ont accompagnée, il ne s’est guère passé un mois sans que la presse, relayant des articles scientifiques ou l’avis de professionnels (psychiatres, pédopsychiatres, psychologues…) ne s’alarme de la dégradation de la santé mentale de la population française, en particulier parmi les jeunes générations.
Dans un rapport paru en novembre 2021, la Défenseure des droits Claire Hédon soulignait combien la crise sanitaire avait agi « comme un révélateur », entraînant une « explosion des troubles psychiques » chez les enfants et les adolescents, mais nous pourrions en dire autant des étudiants, avec une envolée des vécus dépressifs et anxieux, ainsi qu’une augmentation des risques d’addiction[1].
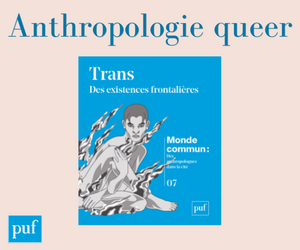
Au cours des deux dernières années, les jeunes générations – une frange de la population a priori peu concernée par le risque de développer une forme grave du Covid-19 – ont été confinées pour protéger les plus âgés. Il se trouve peu de commune mesure, certes, entre cette expérience et celle d’une guerre qui exposerait la vie des jeunes appelés, aussi le terme de « sacrifice » est-il sans doute exagéré. Mais l’accroissement des inégalités entre les générations (un type d’inégalités souvent oubliées au profit de celles de classe ou de genre, par exemple) est une réalité dont l’on aurait tort de sous-estimer la portée.
Voici plusieurs mois, la responsable scientifique de l’étude « Coronavirus et confinement » soulignait que « les jeunes apparaissent les plus touchés par la crise sociale et économique engendrée par la pandémie de Covid-19 et le confinement, en raison de leur précarité aujourd’hui devenue structurelle », ajoutant que « les 18-24 ans constituent la tranche d’âge qui cumule le plus de vulnérabilités, à la fois résidentielles, matérielles et relationnelles[2] ».
L’accroissement objectif de ces inégalités contribue sans doute à attiser les tensions entre
