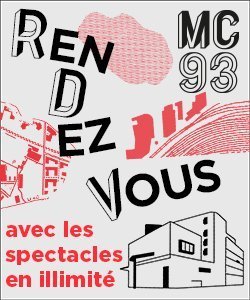La Reprise de Milo Rau ou le spectateur aux prises avec la violence
« Un : il ne s’agit plus seulement de représenter le monde. Il s’agit de le changer. » Après avoir détourné la célèbre « 11e thèse sur Feuerbach » de Marx, le metteur en scène suisse Milo Rau ajoute à ce premier point aussi audacieux que lapidaire : « le but n’est pas de représenter le réel, mais bien de rendre la représentation réelle ». Tout un programme. Rappelant à certains égards le Dogme95 de Lars von Trier et Thomas Vinterberg, ce « Manifeste de Gand », publié le 18 mai 2018, déroule les dix commandements que le nouveau directeur du NTGent, en Belgique, entend suivre dans ses prochaines créations.
Mais ce décalogue artistique ne fait peut-être finalement que théoriser et officialiser la démarche entreprise par Milo Rau depuis les débuts de IIPM, son International Institute of Political Murder : avoir recours à des acteurs non-professionnels, faire entendre plusieurs langues sur scène, interdire les adaptions littérales ou encore prôner la sobriété contre le gigantisme et la débauche de moyens, pour faciliter la diffusion des spectacles, car « au moins une production par saison doit être répétée ou présentée dans une zone de conflit ou de guerre, sans aucune infrastructure culturelle. »
Au minimalisme de la mise en scène répond le foisonnement des questions que le spectacle pose, et même impose.
« Zone de conflit ou de guerre », certes, et cela ne surprendra pas les spectateurs fidèles. Car Milo Rau, avec obsession et détermination, entend disséquer le présent sur le plateau conçu comme un laboratoire pour interroger la violence de nos sociétés, ou plus particulièrement la représentation de cette violence et notre rapport à elle. Des Procès de Moscou sur les Pussy Riot à ses Fives Easy Pieces à propos de l’affaire Dutroux, ou encore sa reconstitution de la radio Mille Collines au Rwanda avec Hate Radio, son théâtre s’oppose a priori au divertissement. Il est certain en tout cas qu’il ne peut laisser indifférent, jusqu’à provoquer un certain malaise