Folie et raison – à propos d’« Histoire(s) de René L. » au Mucem
Avec sa thèse Folie et déraison, histoire de la folie à l’âge classique, soutenue en 1961, Michel Foucault a fait entrer « les malades comme acteurs de l’histoire », attentif qu’il était à leurs visages et à leurs discours. Poursuivant ses recherches sur les institutions disciplinaires accueillant ces « anormaux », le philosophe s’intéressa aussi aux espaces d’enfermement, notamment dans une conférence, « Des espaces autres », prononcée le 14 mars 1967 et publiée en 1984. Il distinguait ainsi deux grands types d’espaces : les « utopies », soit des emplacements sans lieu réel, et les « hétérotopies », soit des lieux concrets, dessinés dans l’institution même de la société, pensés comme des contre-emplacements qui ont « le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces qui sont en eux-mêmes incompatibles ». Des lieux construits à l’intérieur d’une société, mais qui obéissent à d’autres règles.
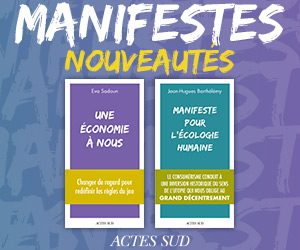
C’est précisément à la hauteur de cette double réflexion sur la folie et sur l’hétérotopie que se mesure l’exposition au Mucem, Histoire(s) de René L. Hétérotopies contrariées, hantée par le spectre de Michel Foucault. Conçue par Béatrice Didier, co-directrice du Point du Jour, centre d’art de Cherbourg, et par l’historien Philippe Artières, spécialiste, entre autres, de l’œuvre du philosophe[1], cette exposition procède autant d’un long travail de connaissances accumulées sur Foucault que d’une attention flottante aux hasards du monde sensible. Comme si les concepts percutaient naturellement les formes, comme si les traces des vies réelles vibraient dans les récits théoriques.
Car c’est en fouillant dans des tas de papiers « à jeter » dans un bâtiment asilaire de la Manche en voie de destruction (la fondation Bon-Sauveur à Picauville) que Philippe Artières et Béatrice Didier sont tombés par hasard sur plusieurs rouleaux de papiers contenant une cinquantaine de dessins au crayon, minutieusement colorés. Des dessins aux traits naïfs, voire enfantins, mais
