Quand l’exclusion politique des classes populaires favorise l’essor du FN/RN
Le constat est sans appel : à l’occasion de l’élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen est, encore une fois, la candidate qui attire le plus les suffrages des ouvriers, des employés et des non-diplômés. Si d’autres segments populaires votent à gauche ou, surtout, s’abstiennent, le vote FN/RN reste particulièrement fort dans les mondes ruraux éloignés des métropoles et touchés par la désindustrialisation.
Comment comprendre cette force du FN/RN en milieu populaire rural ? Peut-on parler d’un mouvement populiste, conservateur, néo-poujadiste[1] ? Quelle fraction de classe mobilise-t-il en priorité ? S’agit-il d’un vote d’adhésion doctrinale ou d’un vote protestataire ? Pourquoi les classes populaires rurales ne votent-elles pas pour les partis de gauche ? Pour répondre sérieusement à ces questions, multiplier les enquêtes précises dans différents contextes serait indispensable. Il faut notamment distinguer les engagements politiques selon leur intensité. Un électeur occasionnel ou régulier, un simple militant ou un porte-parole d’un parti identique n’ont pas forcément grand-chose en commun.
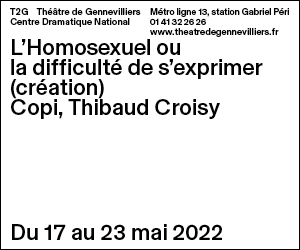
Plus généralement, on ne soutient pas le FN/RN pour les mêmes raisons à Versailles, dans les territoires d’outre-mer ou à Hénin-Beaumont, donc selon les territoires et les milieux sociaux. Encore plus que d’autres partis, le FN/RN a toujours attiré une mosaïque de profils aux attentes contradictoires, qu’il s’agisse de sa base électorale ou militante. L’analyse de la dynamique autour de Marine Le Pen ne peut donc pas se réduire à une explication univoque.
Cette fragmentation du FN/RN se retrouve dès l’échelle microscopique d’une ville populaire de Lorraine, Grandmenil[2], 5 500 habitants. J’y observe, depuis 2014, des membres du FN[3] mais aussi d’autres acteurs non-frontistes (élus locaux, Gilets jaunes, simples habitants). Cette approche ethnographique permet de replacer les pratiques politiques dans leur contexte social. Seul parti actif à Grandmenil, le FN y mob
