Un accès alternatif à internet est-il possible ?
On l’ignore souvent, mais internet, nouvelle technologie du début des années 1990, a d’abord été fourni au public, en France, comme en Allemagne, par de petites associations à but non lucratif. En effet, des ingénieurs, des étudiants, ainsi que des passionnés issus des milieux artistiques et alternatifs ont monté de toute pièce des fournisseurs d’accès à internet (FAI) pour des publics confidentiels mais déjà extérieurs au premier groupe d’utilisateurs des « amateurs éclairés »[1]. Au cours des quelques trente années qui nous séparent de ces débuts, internet a bien évolué au fil de sa « démocratisation »[2].
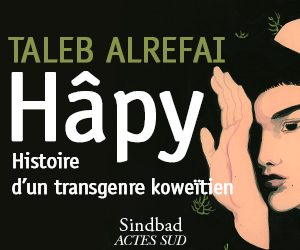
D’abord utilisé principalement dans les universités, internet a très rapidement fait l’objet d’offres commerciales de la part des opérateurs de télécommunications, notamment les entreprises nationales. Ces usages et son paysage se sont également métamorphosés. L’intense usage des médias sociaux, l’omniprésence des smartphones, le développement du commerce en ligne inspirent à certains un triste constat au tournant des années 2020. L’« l’utopie a déraillé », donnant « un pouvoir immense sur nos existences aux géants du numérique » déclare Tim Berners-Lee, inventeur du web, au journal Le Monde en 2019[3].
Ce constat, plusieurs documentaires[4] et essais, souvent à la frontière entre le monde académique, médiatique et militant, le détaillent et lui opposent des alternatives possibles[5].La solution proposée est souvent de recourir aux outils libres et open source qui constituent autant d’alternatives aux services propriétaires sans reposer sur le modèle commercial de ces derniers, voire même d’« élaborer une nouvelle architecture du web » synonyme de retour aux « origines du Net[6]».
Pourtant, nulle trace dans ces tribunes des fournisseurs d’accès à internet associatifs qui continuent d’agir au nom du droit à la connexion à internet, de la défense de la « neutralité du net », de la promotion, enfin, d’un « modèle associatif » fondé sur le refus de la co
