Contre « le pouvoir d’achat »
« Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir. »
Victor Klemperer, LTI. La langue du IIIe Reich, 1947
Au cours de la dernière élection présidentielle, les instituts de sondage, les journalistes, les politiques et les syndicats semblent s’être accordés sur un point crucial : le pouvoir d’achat serait la préoccupation majeure des Français. De manière pour le moins surprenante, les disputes statistiques et les discussions expertes sur l’inflation, la TVA, l’évolution des prix et le seuil de pauvreté ont laissé de côté les conséquences délétères de cette mise en agenda.
À un moment où le dérèglement climatique nous imposerait un nouveau rapport au monde, fait de sobriété énergétique, de décroissance matérielle et de réconciliation avec le vivant, « l’augmentation du pouvoir d’achat » est un sinistre anachronisme. En effet, la notion de pouvoir d’achat réduit l’action à la consommation et le pouvoir d’« agir à plusieurs » qui anime en principe la vie démocratique à un pouvoir individuel.
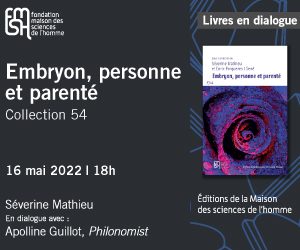
Cette double réduction, de l’action à l’achat, du citoyen au consommateur, individualise et dépolitise les souffrances et les revendications qui auraient pu prendre une tout autre voie, bien plus collective et émancipatrice : celle de la justice sociale.
La mise en berne du pouvoir
On le sait bien, le langage, même lorsqu’il est prétendument utilisé pour décrire de façon transparente un état de choses ou pour échanger des informations, est toujours une façon de faire les choses. En délimitant l’éventail de ce qui est possible ou impossible, dicible ou indicible, sensé ou insensé, il assigne des places et affecte le cours des événements. Les « éléments de langage » préfigurent les émotions qu’ils sont susceptibles de déclencher, proposent des programmes d’action et dessinent les contours des collectifs qu’ils affectent et concernent
