La tradition émergente de la diplomatie climatique
La zone la plus froide de la planète a connu un épisode de variabilité climatique jamais enregistré. En mars 2022, la station franco-italienne Concordia, située dans l’Est de l’Antarctique, a mesuré un record de chaleur qui dépassait de 36°C les relevés moyens. La cryosphère montre une réaction de plus en plus vive au réchauffement du climat. Les conséquences en sont connues, comme le sabotage des villes côtières, des variations de températures compromettant les récoltes mondiales, ou le dégel du pergélisol et son cortège de catastrophes en chaîne. Mais puisqu’il est soit trop tôt, soit scientifiquement insuffisamment fondé d’en référer comme un signal du changement climatique, cet événement n’apparaît pas au registre de l’actualité diplomatique.
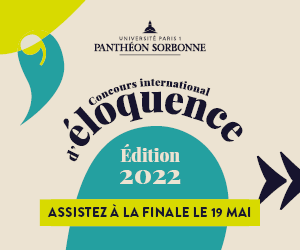
Inversement, certains événements typiques du ressort des chancelleries ne récupèrent pas le label « d’événement climatique » qui pourrait leur être dû. Pour le seul mois de janvier 2022, pouvait être noté, entre autres, que les États-Unis annulaient leur soutien financier au gazoduc EastMed au profit de la Grèce en raison d’un « Green agenda », que des révoltes au Kazakhstan, désormais surnommées « Bloody January », avaient fait suite à la fin des subventions publiques au gaz de pétrole liquéfié, que pour sanctionner la junte militaire au pouvoir la CEDEAO suspendait tout passage frontalier vers la Mali à l’exception des produits pétroliers, que Total Énergies se retirait de Birmanie en raison de la dégradation des droits humains, ou que la police israélienne et des bédouins s’étaient affrontés au sujet d’un projet d’afforestation dans le désert du Néguev.
L’irruption du climat dans les affaires internationales est une question architectonique. Elle échappe aux représentations conventionnelles des diplomates, pourtant férus d’étiquettes. Il faudra toujours rappeler que « l’interétatisme » est par nature impropre à réguler le phénomène de l’effet de serre. Il n’y a pas d’interlocuteur légitime principal. Pourtant,
