Nous sommes dans la guerre
Nous voici au 5ème mois de la guerre déclenchée par l’invasion russe. Dans ce texte[1], j’essayerai de mettre en ordre quelques-unes des réflexions que m’inspirent la situation en Ukraine et ses prolongements planétaires. Je formulerai des hypothèses et poserai des questions, mais je n’ai pas de certitude absolue quant à la réponse qu’il faut leur apporter. Sur plusieurs points je me demande même si ces réponses existent – sauf à vouloir projeter sur la réalité qui nous assiège des catégories idéologiques toutes faites. Mais ce n’est pas une raison, bien au contraire, pour ne pas tenter d’articuler ce que nous savions déjà et ce que nous apprenons au jour le jour, de façon à éclairer les enjeux et les éventualités d’un conflit qui nous concerne tous directement. Devant la guerre d’Ukraine en effet, devant la bataille qui fait rage autour des villes du Donbass, devant les menaces qui s’accumulent aux alentours, nous ne pouvons pas nous comporter comme de simples « observateurs engagés » qu’affectent plus ou moins les événements.
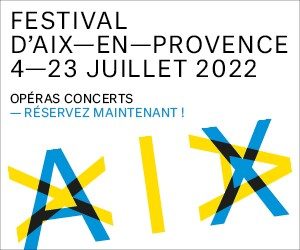
C’est notre avenir, c’est notre « monde commun » qui sont en jeu, et dont la physionomie va dépendre aussi de nos interprétations et de nos choix. En ce sens, toutes proportions gardées car – ne l’oublions jamais – nous ne sommes pas les combattants ou les victimes directes du conflit, je dirai pourtant que nous sommes dans la guerre, car elle a lieu « chez nous » et « pour nous ». Nous n’avons pas le choix, hélas, comme le propose dans une belle leçon de pacifisme révolutionnaire mon ami le philosophe Sandro Mezzadra, de « déserter la guerre ».[2] Je n’en conclus pas pour autant que nous devions nous laisser « mobiliser » et emporter par elle d’une façon irréfléchie. La marge laissée au choix est très faible, mais faut-il décider d’avance qu’elle est inexistante ?
De quelle guerre, cependant, sommes-nous ici en train de parler ? Sur ce point déjà l’incertitude règne. Car au-delà du fait que le territoire ukrainien (en partie occupé
