La part bancaire des politiques sociales
L’État doit-il intervenir pour faire baisser le prix de l’essence ? Faut-il qu’il plafonne les prix des denrées agricoles ? Le gouvernement doit-il relever le SMIC ? En ces temps de campagne électorale et de crises imbriquées, la question dite du « pouvoir d’achat » des ménages est posée de multiples façons. L’État est sommé de le protéger voire de l’améliorer. Cette demande est loin d’être purement quantitative : cette « inquiétude pour le pouvoir d’achat », parle d’incertitude, de la crainte de ne pas être en mesure de maintenir un modèle de vie de classe moyenne pour soi et pour ses enfants, la promesse de l’État social.
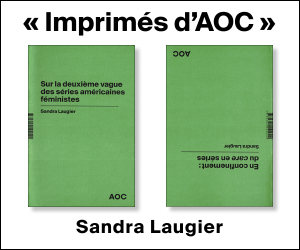
Protéger l’argent des ménages
Mes recherches, qui portent sur les politiques bancaires et sur les usages de l’argent, m’ont conduite à mettre au jour, dans un livre récent, la fonction étatique de protection de l’argent des ménages et de leurs capacités de consommation[1]. Depuis deux décennies, les politiques de l’argent sont devenues un espace d’action publique structuré, sollicité pour lutter contre la pauvreté.
Cette part bancaire des politiques sociales a pris une place croissante du fait de trois phénomènes concomitants : d’abord le recul de l’État social et l’augmentation des risques qui pèsent sur les individus ; ensuite la financiarisation de l’argent des ménages. L’économie domestique est de façon croissante imbriquée dans les soubresauts de la finance, car les banques ont depuis les années 1990 multiplié les produits proposés et se sont marchandisées (alors que la bancarisation française s’était faite sur un modèle de quasi-service public bancaire).
La troisième évolution concerne les modalités de gouvernement, davantage fondées sur la régulation que sur l’intervention directe. L’une des nouvelles façons de protéger consiste à utiliser les espaces marchands, et en particulier ceux de la banque et de la finance, pour résoudre des questions de politiques publiques. Esping-Andersen a classiquement défini l’action de l’État socia
