Les nerfs et la couleur – sur « Oskar Kokoschka – un fauve à Vienne »
Il signe « OK » dans le coin de ses toiles, comme un poinçon ironique ; par instants, c’est une vision absurde : l’enthousiasme léger de ces deux lettres qui nargue les faces inquiètes, déformées par un tourment manifeste, des portraits de Kokoschka. Surnageant à la surface de toiles aux couleurs brutales, de silhouettes aux grouillements incertains, proches de la décomposition, sa signature-locution sonne comme une pleine approbation, malgré tout.
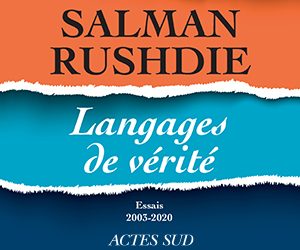
Né en Autriche-Hongrie en 1886, « OK » a vécu presque cent ans ; il traverse le siècle en ogre-peintre, mais aussi dramaturge, écrivain, soldat ; la société viennoise le surnomme oberwildlingle (« le plus sauvage d’entre tous ») ; en réponse à ce sobriquet, l’artiste de 25 ans se rase la tête ; il établit sa réputation d’effronté.
L’archiduc François-Ferdinand, après avoir vu ses œuvres à l’exposition du Hagendbund de 1911, aurait dit : « cet homme mérite qu’on lui rompe tous les os jusqu’au dernier »[1]. En 1933, les Nazis le qualifient d’artiste « dégénéré ». Le peintre réplique en 1937 par un tableau intitulé « Autoportrait d’un artiste dégénéré » où, yeux fixes et bras croisés, il arbore une calme défiance, celle de l’inébranlable foi en son art, riposte et protection contre l’hostilité du monde.
La rétrospective du Musée d’Art Moderne, après celles de 1974 et 1983, est la première d’une telle ampleur. Elle donne à voir plus de 150 œuvres qui parcourent 70 années de création où le plus saisissant se tient dans le rapport du peintre à la couleur, les teintes ne cessant d’évoluer, du sombre au presque criard, en passant par, à l’apogée, sa période fauve, où la couleur brute explose.
Les premières toiles de Kokoschka, entre 1909 et 1913, sont essentiellement des portraits. On les dirait sortis d’une boue souterraine, encore couverts des scories des sous-sols ; bien que colorées, ses toiles sont dominées par des tonalités ombreuses, saturniennes ; la touche y est à la fois tremblante et vigoureuse, le désordre
