L’Algérie en deux tragédies – sur des romans de Kaouther Adimi et Mathieu Belezi
L’Algérie inspire deux beaux romans extrêmement différents par leur construction narrative et les points de vue adoptés, par leur chronologie aussi, mais semblables par la pureté de leur style, la tragédie à laquelle ils se confrontent et la force de leur propos : Au vent mauvais de Kaouther Adimi et Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Belezi.
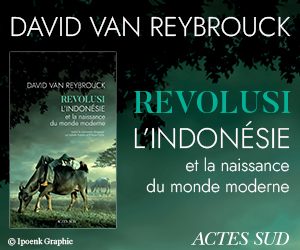
Le roman de Kaouther Adimi a pour point de départ narratif un sujet totalement méconnu, dont elle a découvert l’existence en allant enquêter dans les archives départementales des Yvelines. Une révolte de soldats dits « africains » (pour beaucoup en fait nord-africains) enrôlés dans l’armée française pendant la Seconde Guerre Mondiale, et qui attendirent des semaines à Versailles dans des conditions déplorables l’autorisation de rentrer chez eux en Algérie notamment. À travers l’histoire de Tarek, jeune berger qui sera l’une des figures de cette révolte, on touche du doigt le drame de ces hommes qui étaient suffisamment français pour se battre à Monte Cassino et libérer l’Europe, mais qui ne le furent plus suffisamment pour être traités avec la justice à laquelle ils avaient droit une fois la guerre finie, et gagnée.
Kaouther Adimi raconte, avec un sens aigu de la narration, les brimades, les humiliations, la ségrégation de ces dizaines de soldats entassés dans une caserne infâme à Versailles, et à qui les cinémas, les cafés, les restaurants, étaient interdits.
Son roman s’articule autour d’un trio de personnages. Outre Tarek, le berger, son frère de lait Saïd, le lettré devenu écrivain. Autant l’un est pauvre, fils d’une mère muette et d’un père mort au travail le lendemain de sa naissance, autant l’autre vient d’une grande famille algérienne, cultivée et pétrie d’idéaux. Le père de Saïd est en effet un imam qui fait l’instruction des enfants du village et à qui le gouvernement colonial interdit en 1937 de leur enseigner l’arabe.
Tous deux sont très opposés mais leur enfance commune a créé entre eux un lien ind
