Le chercheur en sciences humaines et sociales : un modèle de l’intellectuel au XXIe siècle
À quoi ressemble une vie de chercheur ? Le flou programmatique de sa fonction aux yeux d’un public profane se mêle aujourd’hui à un trouble existentiel exprimé par les intéressés eux-mêmes. « La vie de laboratoire », pour reprendre le titre d’un vieux livre de Bruno Latour et Steve Woolgar, inaugurant dès la fin des années 1970 un courant abondant d’études savantes sur les conditions de production des faits scientifiques, s’est tellement transformée ces vingt dernières années qu’elle suscite de plus en plus de réflexions, oscillant entre colère et résignation, entre combat contre ses nouvelles normes et intériorisation mécanique de la plupart d’entre elles.
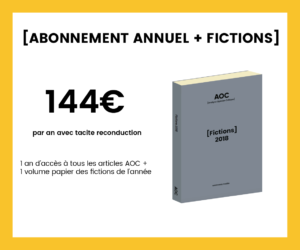
La figure particulière du chercheur en sciences humaines et sociales (SHS) incarne à elle seule la difficulté actuelle à faire exister les faits scientifiques dans le débat public : les faire connaître en dehors du monde académique, autant que les produire, compte tenu des contraintes qui pèsent sur les conditions de travail. Car tout a changé depuis vingt ans dans l’exercice du métier de chercheur en SHS : le nombre croissant des universitaires ; la précarisation des statuts et des conditions de vie, liées à cette massification et aux politiques publiques de plus en plus contraignantes, mais aussi la réputation sociale ternie, après un temps qui les consacrait comme des figures admirées du débat public.
Cette difficulté nouvelle du métier de chercheur procède en effet d’une perte de prestige symbolique des sciences humaines et sociales. Au cœur du paysage scientifique, leur place de plus en plus réduite depuis les années 1980 a valeur d’indice d’un déplacement d’un rapport au savoir intellectuel. Alors qu’elles attiraient la majeure partie du monde intellectuel dans les années 1960-70, elles ne suscitent plus le même entrain. Si ces disciplines disposent encore d’un appareil institutionnel solide (revues, diplômes, associations professionnelles, laboratoires…), elles « apparaissent menacées par des discours qui
