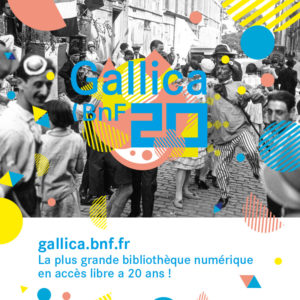La France ne peut conserver toutes les beautés du monde
La célèbre phrase de Michel Rocard quant à l’impossibilité d’accueillir toute la misère du monde, prononcée à la fin de l’année 1989 alors qu’il était Premier ministre, a inspiré, après beaucoup d’autres responsables politiques depuis près de 30 ans, Emmanuel Macron qui l’a cité explicitement en marge d’une visite d’un centre parisien des Restos du cœur le 21 novembre 2017. Exactement une semaine plus tard, sur ce qui pourrait apparaître comme un tout autre sujet, et sur un autre continent, le président Macron prononçait un discours programmatique devant les étudiants de Ouagadougou dans lequel il s’engageait à ce que « d’ici à cinq ans [le temps de son mandat, donc] les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ».
Cette courte séquence politique invite à lire ces deux prises de parole à l’aune l’une de l’autre, d’autant que le président de la République vient de nommer deux experts, les universitaires Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, qui se voient donc confier la mission délicate de faire des préconisations concrètes d’ici le mois de novembre prochain pour la restitution du patrimoine africain.
Non seulement il est temps de s’interroger, mais il est aussi désormais possible de remédier à cette asymétrie patrimoniale qui entretient la blessure de la colonisation.
D’une grande importance, non pas seulement symbolique, ce projet est censé ouvrir une nouvelle page des relations entre la France et un certain nombre de pays d’Afrique à l’instar du Bénin, du Mali, du Sénégal… dont les objets rituels ont été parmi ceux que les Français (militaires, missionnaires, anthropologues…) ont acquis dans des circonstances coloniales brutales qui troublent la légitimité de leur présence, même magnifiée, dans les collections de nos musées. Que la transaction ayant présidé à leur acquisition ait été monnayée, ou pas, qu’elle ait été engagée dans de bonnes intentions, ou pas, comme l’écrivait Michel Leiris :