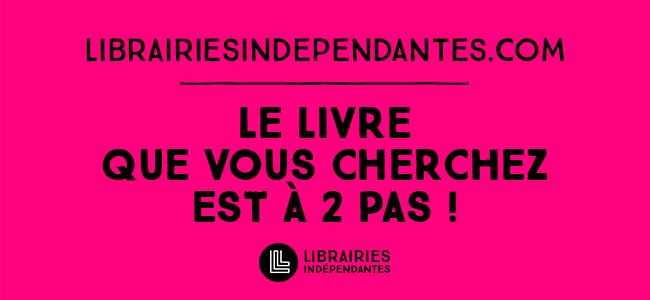La politique étrangère britannique au tournant
La crise diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie, causée par l’empoisonnement en Angleterre d’un ex-espion russe qui avait travaillé pour les services britanniques, est venue rappeler que la perspective du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, prévue dans un an maintenant, soulève beaucoup de questions sur l’avenir de la politique étrangère britannique et sa capacité à se faire entendre sur la scène internationale. Certains commentateurs se sont demandé si le régime russe n’avait pas aussi cherché à tester la solidarité occidentale et la faiblesse britannique dans le nouveau contexte créé par le référendum du 23 juin 2016. Le Brexit représente incontestablement un défi nouveau pour la diplomatie britannique, à la recherche d’un équilibre entre l’ambition d’une reconquête d’une souveraineté extérieure hors UE et le besoin de conserver l’unité et la solidarité du continent européen.
Jusqu’à présent, la politique étrangère reposait essentiellement sur un double pilier, l’Alliance atlantique et l’Union européenne, auquel s’ajoutaient, dans une moindre mesure, des relations bilatérales avec un certain nombre de pays, notamment du Commonwealth. La « relation spéciale » avec les États-Unis, établie depuis la Seconde Guerre mondiale, avait permis à la diplomatie britannique de préserver une certaine influence malgré la fin de son empire et son déclin relatif, tout en participant à l’établissement des institutions multilatérales garantes de l’ordre libéral depuis 1945, particulièrement les Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale ou le GATT. Par sa dimension militaire, à la fois bilatérale et multilatérale au sein de l’OTAN, cette coopération anglo-américaine a aussi aidé Londres à garder son rang de grande puissance. La participation au projet européen depuis 1973, de son côté, lui permettait l’accès au premier marché économique mondial et à une coopération en matière de politique étrangère avec les 27 autres États-membres à l’effet multiplicateur de puissance. Contrairement à une idée reçue en France, la diplomatie britannique a en effet toujours joué un rôle actif dans cette coopération européenne, y compris sous Margaret Thatcher.
En apparence, le premier pilier de la politique étrangère britannique n’est pas affecté par le référendum sur le Brexit. Dans la rhétorique actuelle du gouvernement May, il est constamment fait référence à la relation spéciale avec les États-Unis, et Donald Trump lui-même s’est prononcé peu après son élection pour la signature d’un accord de libre-échange rapide avec le Royaume-Uni après sa sortie de l’UE, qu’il considérait comme une excellente décision. Concrètement cependant, les intérêts britanniques et américains ont rarement été aussi divergents qu’aujourd’hui. May et Trump ne sont d’accord sur aucun des grands dossiers internationaux du moment, que ce soit sur l’accord nucléaire iranien que le président américain veut résilier, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, le protectionnisme en matière commerciale ou la Corée du Nord. Par ailleurs, si l’on en croit le précédent de l’ALENA par exemple, la possibilité de négocier rapidement un accord de libre-échange avec les États-Unis paraît assez peu vraisemblable. Enfin et au-delà du caractère conjoncturel et hors norme de la présidence Trump, il n’est pas certain que les Américains, quel que soit le gouvernement au pouvoir, accordent beaucoup d’importance à l’avenir, en dehors de la coopération militaire et du renseignement, à un Royaume-Uni qui serait isolé en Europe. Depuis le « pivot » vers l’Asie de Barack Obama, l’Europe dans son ensemble, Royaume-Uni compris, n’est de toute façon plus en tête des priorités diplomatiques américaines.
Paradoxalement, puisque la question de la souveraineté a été au cœur de la campagne référendaire, la coopération européenne en matière de sécurité et de défense est moins controversée outre-Manche et devrait se poursuivre plus facilement.
Le volet européen est celui qui est le plus évidemment affaibli par le Brexit. Il est pour l’instant difficile d’évaluer précisément la nature future des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, qui dépendront des négociations en cours. Officiellement, le gouvernement britannique ne cesse de répéter que le pays va sortir de l’Union européenne mais non de l’Europe et qu’il souhaite conserver une forte proximité avec le continent dans tous les domaines, sans toutefois être assujetti aux règles de l’UE. Deux principaux domaines sont en discussion, la nature des relations économiques et commerciales d’un côté, la coopération en matière de sécurité et de défense de l’autre. Ce sont surtout les premières qui posent problème pour l’instant, en raison des désaccords internes au gouvernement britannique et au blocage sur la question de la libre circulation des personnes. Les anti-européens les plus ardents outre-Manche souhaitent couper les ponts avec le continent tandis que les anciens Remainers souhaitent garder des liens économiques et commerciaux aussi étroits que possible pour limiter les impacts négatifs du Brexit sur l’économie britannique. Theresa May a choisi d’exclure de rester dans le marché unique et l’union douanière, qui supposeraient de continuer à accepter la libre circulation pour les ressortissants européens. Or l’argument du contrôle de l’immigration a joué un rôle majeur dans le résultat négatif du référendum. Theresa May souhaiterait donc rester hors du marché unique mais y avoir un « accès » sélectif, secteur par secteur (incluant certains services) et signer un accord douanier spécifique, ce que les négociateurs européens, menés par le Commissaire Michel Barnier, refusent. Pour l’instant, un accord de transition a été trouvé, portant sur la période allant de mars 2019 à décembre 2020, qui maintient plus ou moins le statu quo sur le marché unique et la libre circulation (mais sans pouvoir de décision pour Londres, qui ne sera plus membre de l’UE), en attendant un accord définitif. Celui-ci risque de se réduire à un traité de libre-échange, qui aurait des conséquences négatives sur l’économie britannique s’il ne porte pas sur les services, qui représentent 80 % du PIB.
Paradoxalement, puisque la question de la souveraineté a été au cœur de la campagne référendaire, la coopération européenne en matière de sécurité et de défense est moins controversée outre-Manche et devrait se poursuivre plus facilement. Le gouvernement a fait part de son intention de négocier un accord dans ce domaine avec l’UE, qui s’ajouterait aux relations bilatérales existantes, et il a reçu un accueil favorable à Bruxelles. Londres souhaiterait pouvoir continuer à participer à des programmes tels que le mandat d’arrêt européen et l’Agence européenne de défense (pour les programmes d’armement) et poursuivre la coopération transfrontalière en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme. À la conférence sur la sécurité de Munich au début de 2018, les trois responsables des services de renseignement britannique, allemand et français ont lancé un appel à cet effet. Dans le domaine de la défense, il est aussi envisagé de pouvoir continuer à participer à certaines missions extérieures, même si le Royaume-Uni ne pourra plus les mener, comme c’est le cas aujourd’hui pour l’opération anti-piraterie Atalante. L’influence britannique sera de toute façon réduite par son absence autour de la table où les décisions seront prises.
Le slogan de « Global Britain » est omniprésent dans le discours officiel mais, il reste peu défini et finalement assez creux.
Pour compenser sa perte d’influence en Europe, le gouvernement compte sur d’autres horizons. Theresa May et son Secrétaire au Foreign Office (Boris Johnson) affirment que, loin de se retirer du monde, le Royaume-Uni post-Brexit sera « global », c’est-à-dire ouvert sur le monde, défendant le libre-échange, les intérêts et l’influence britanniques sur toute la surface du globe. Il s’agira en particulier de développer des échanges avec les pays émergents, dont les niveaux de croissance sont sans commune mesure avec ceux des pays européens. Le slogan de « Global Britain » est omniprésent dans le discours officiel mais, comme l’a fait remarquer un rapport très critique de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes, il reste peu défini et finalement assez creux : aucune stratégie ni objectifs précis ne lui ont été assignés par le Foreign Office, qui est pourtant privé de la responsabilité des négociations chronophages sur le Brexit depuis que Theresa May leur a créé un ministère dédié (Department for Exiting the EU) et devrait donc avoir le loisir de penser stratégiquement. Par ailleurs, on voit mal en quoi l’Union européenne empêcherait de rechercher de nouveaux marchés pour les produits et services britanniques dans les pays émergents – l’Allemagne ne semble pas avoir été empêchée de le faire par l’UE. Enfin, l’isolement de Londres en Europe n’incitera pas forcément des pays asiatiques ou du Commonwealth, pourtant historiquement proches de Londres, à engager prioritairement des négociations avec le Royaume-Uni, moins intéressant sur le plan commercial que l’UE dans son ensemble. Les visites effectuées par la Première ministre dans certains de ces pays n’ont pas abouti aux effets escomptés. Ainsi le Premier ministre japonais Shinzo Abe a rappelé qu’il était opposé au Brexit, qui risquait de poser problème aux constructeurs automobiles japonais présents au Royaume-Uni, qui exportent les voitures sur le continent européen. Quant à son homologue indien, Narendra Modi, il s’est dit intéressé par la perspective d’un accord de libre-échange uniquement si le gouvernement britannique augmentait sensiblement le nombre de visas pour les ressortissants indiens, ce que Theresa May a refusé de promettre.
La politique étrangère britannique est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Le débat britannique au moment du référendum sur la sortie de l’Union européenne a beaucoup porté sur la question de la souveraineté nationale, qui aurait été affaiblie par Bruxelles et qu’il s’agirait de récupérer. Il a beaucoup moins été question de la réalité de l’interdépendance entre les pays européens sur la scène internationale, qu’il va maintenant falloir pour Londres accommoder avec les ambitions illusoires d’un Global Britain.