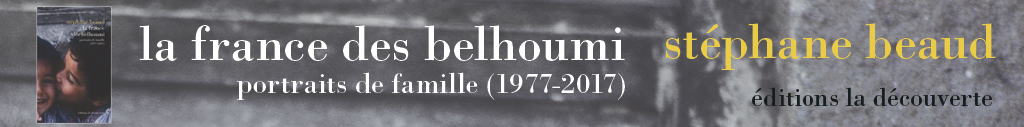Outre-mer, le retour du politique
Le 17 mars 2017, lors de la 14e conférence de la Convention de Carthagène qui se tenait à Cayenne en Guyane, un groupe d’hommes cagoulés force les barrières de sécurité et fait irruption dans la salle, prend à partie Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, en dénonçant l’inaction du gouvernement face à l’insécurité dans le territoire. Ces hommes du « Collectif des 500 frères » créé quelques semaines plus tôt étaient les membres les plus visibles d’un mouvement social de très grande ampleur qui, au fil des semaines, a réuni l’ensemble des secteurs économiques et sociaux de la Guyane, dans un contexte d’élections présidentielles au niveau national. Le mouvement « Pou Lagwiyan Dékolé » était alors porteur d’un ensemble large de revendications allant de la construction d’établissements scolaires aux délais de paiement des entrepreneurs dépendant de la commande publique, de la facilitation de l’accès aux soins à la lutte contre l’insécurité.
Les blocages et manifestations – dont celle du 28 mars qui réunit plus de 15 000 personnes sur un territoire en comptant environ 250 000 – aboutirent à une grève générale qui (re)mit au jour des situations d’inégalités sociales, économiques et des difficultés d’accès aux services publics bien plus grandes, bien plus marquées qu’au niveau national et même que dans les autres territoires ultramarins, Mayotte exceptée. C’est précisément dans ce territoire que se sont déroulées plusieurs semaines durant un mouvement d’ampleur portant largement sur les mêmes enjeux que la grève guyanaise de 2017 : insécurité, inégalités sociales et économiques, pauvreté, accès aux services publics, qualité des infrastructures de soins, immigration, etc.
Ces évolutions et les débats qui les ont accompagnés ont paradoxalement contribué à dépolitiser et techniciser les enjeux sur le développement politique, économique et social en outre-mer.
La départementalisation de Mayotte en 2011 constitue l’un des épisodes importants d’une série de