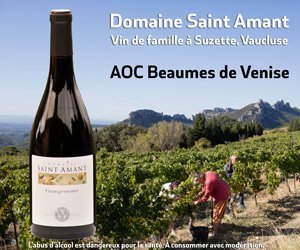Le football, passionnément politique
Le 11 juillet 1982 à Madrid, dans le stade Santiago Bernabeu, l’Italie affronte la RFA en finale du Mundial. À la 69ème minute, le milieu Marco Tardelli marque le but du 2 à 0. Assis aux côtés du roi d’Espagne, le président socialiste de la République italienne Sandro Pertini exulte. Il se lève, se retourne vers les spectateurs assis derrière lui et manifeste avec exubérance son enthousiasme. À la même période en France, la fièvre du football n’a pas atteint le plus haut sommet de l’État. En 1984, François Mitterrand n’est pas présent lors du match d’ouverture de l’Euro [1], pourtant organisé sur le sol national et, durant ses deux mandats, il n’est jamais venu saluer les footballeurs français à la veille d’une grande compétition.
Trente quatre ans plus tard, le tableau est bien différent. Quelques jours avant le départ de l’équipe de France masculine pour la Coupe du monde en Russie, Emmanuel Macron a rendu visite aux joueurs et leur a tenu un discours d’encouragement organisé autour de quelques mots-clefs à la résonance très politique : unité, effort, confiance. Pour la première fois, un président de la République française s’est ensuite livré longuement sur son rapport au football pour l’émission Téléfoot, diffusée sur TF1, et a eu notamment ces mots : « Le football est un sport qui compte dans notre pays, du très local à l’international. Le football fait partie de ces quelques sports qui permettent de donner une place, de rêver qu’on a un avenir possible, justement parce qu’il y a des modèles. Nos joueurs, les vingt-trois, ce sont tous des modèles de réussite par le sport, de réussite républicaine ». Dans une interview accordée presqu’au même moment au journal Le Monde, son prédécesseur François Hollande affirme : « En France, tout est politique. Même le sport » [2]. Longtemps peu légitime, comment le football est-il devenu, dans notre pays, une passion politiquement incontournable ?
Des investissements politiques à la mesure des enjeux
On peut d’abo