La fin du monde et le Mal qui vient
Qu’on se rassure : il n’entre pas du tout dans mes buts de gâcher votre rentrée en citant les chiffres effectivement catastrophiques de la canicule de cet été, d’évoquer la mousson dévastatrice qui dévaste actuellement le sud de l’Inde, de faire la moindre allusion à la fonte du permafrost (que je croyais cantonnée à la lointaine Sibérie, mais qui vient de frapper les Alpes), pas davantage de faire le rapprochement avec les nombreux abandons de politique environnementale aux États-Unis et, me dit-on aussi, en France, et moins encore, voire franchement pas du tout, avec la désertification, les famines, les crises économiques, les guerres civiles et les exodes massifs qui vont en résulter sous peu. Tous, nous avons appris à vivre avec ces petites bouffées d’anxiété où, pour le salut de notre digestion psychologique, la surface encore lisse d’un quotidien sans accidents notables enrobe des anticipations d’une amertume effroyable – et la pilule passe.
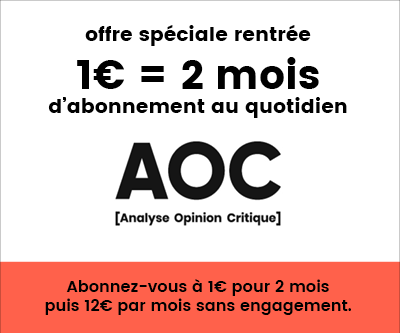
C’est qu’il y a des choses dont nous avons si peur qu’il est « impossible » (lisez « impensable ») de croire qu’elles vont effectivement arriver. Parmi elles, la fin de l’humanité tient une place de choix. Car nous n’ignorons nullement les facteurs de destruction écologique de la planète, ni les désastres géopolitiques qui vont suivre. C’est plutôt qu’une préférence bien compréhensible pour une issue heureuse entache la juste compréhension des processus. Pourtant, bizarrement, ils sont très intelligibles. Car la fin du monde et de l’humanité dont il s’agit ici ne doit rien à la religion, ni à rien d’irrationnel : l’apocalypse matérielle et non spirituelle qui nous est promise est selon le mot de Günther Anders une « apocalypse sans royaume » : une fin sèche qui ne révélera rien et ne justifiera personne. Mais ce n’est pas non plus le genre de fin du monde que causeront de grands événements astronomiques, comme l’explosion du soleil, dont on parle avec détachement parce que les durées en jeu ne nous concernent plus. Ce qui
