Sortir de la « merde anhistorique » ! Face à la complexité du monde 1/2
Chercheur transgenre disciplinaire, encore qu’ethniquement politiste de par ma formation initiale, je suis souvent affligé, et confondu, devant la superficialité et, pour tout dire, la débilité – dans les deux sens du terme – du débat public sur les questions internationales. Ce sont toujours les mêmes mots valises que transportent les responsables politiques ou administratifs, et bon nombre de journalistes, pour commenter l’actualité : la globalisation, la gouvernance, la corruption, la société civile, l’État faible ou en faillite, l’identité, et tutti quanti.
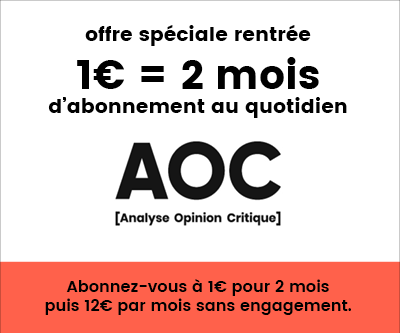
D’une situation à l’autre, à droite comme à gauche, les mêmes pseudo-explications sont ressassées sans aucune considération pour leur arrière-plan historique, comme si les problèmes étaient identiques, et comme si les solutions devaient donc l’être elles aussi : toujours plus de d’élections, toujours plus de société civile, toujours plus de transparence, toujours plus de libéralisation économique, toujours plus de réformes, etc. « pour que tout reste pareil », ou à peu près, du point de vue de la domination politique. La plupart des paradigmes en vogue participent d’un évolutionnisme historiciste très daté – ce sont des surgeons du positivisme du XIXe siècle –, et définitivement niais : la « transition à la démocratie et (bien sûr !) à l’économie de marché », le « développement », l’« émergence », autant de visions normatives, parfois de connotation religieuse et rédemptrice, sinon millénariste, qui devraient d’ailleurs nous amener à nous interroger sur la dernière coqueluche des médias et des cercles politiques, la « transition énergétique », une de plus.
Or, qui peut croire que la complexité du monde puisse se résumer à une alternative entre avancer et reculer, selon le vieil adage du volontarisme populaire : « qui n’avance pas recule » ? Qui peut se satisfaire d’un métadiscours qui s’autoproclame capable de rendre compte, dans les mêmes termes, du devenir de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Afrique,
