La gauche et l’immigration
Sans pouvoir insister ici sur une question que j’ai amplement développée dans un livre, récent[1], je voudrais commencer par rappeler que les migrations ont toujours été une dimension centrale dans l’histoire des classes populaires. Quitter sa terre, son quartier, son pays pour échapper à la misère ou à la violence a été la solution qui s’est imposée comme un ultime recours pour des millions d’individus. Ce n’est donc pas la mobilité en elle-même qui est un phénomène nouveau, mais les formes différentes qu’elle a prise au cours du temps et le type de contrôle qu’ont développé les autorités chargées de défendre les intérêts des « insiders ». Car une autre constante qui s’observe sur la longue durée, c’est que les migrations humaines ont le plus souvent été perçues par ces derniers comme une menace. C’est pourquoi les pouvoirs en place ont imaginé des solutions de plus en plus perfectionnées pour maîtriser les flux, les canaliser, voire même les interdire.
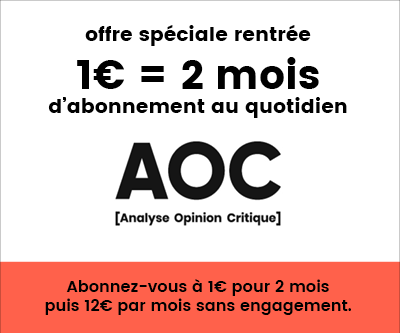
Il faut toutefois souligner que jusqu’au milieu du XIXe siècle, la question migratoire n’était pas étroitement reliée à la question nationale. Sous le Second Empire, c’est l’afflux des ruraux dans les villes, et surtout à Paris, qui préoccupait les autorités. À cette époque en effet, un profond fossé séparait encore les élites et les classes populaires, ces dernières étant perçues comme une masse indifférenciée et potentiellement menaçante, comme l’a montré l’historien Louis Chevalier dans le livre intitulé : Classes laborieuses, classes dangereuses. C’est pour tenter de surveiller les déplacements d’un peuple jugé trop mobile que les autorités ont mis en place les « passeports à l’intérieur » et les livrets ouvriers, contraignant les voyageurs à signaler leurs déplacements dès qu’ils franchissaient les limites de leur département. Dans le domaine social, l’attribution des secours aux indigents était encore directement connectée au domicile. Les bureaux de bienfaisance étant réservés à ceux qui habitaient la commune, les mendiants étaient expulsés dans leur paroisse de naissance. Pendant les périodes de crise, le critère du domicile était fréquemment mobilisé par les ouvriers pour exiger le renvoi de ceux qui n’étaient pas originaires de la commune.
En 1870, l’avènement de la IIIe République provoqua le début d’une rupture profonde avec cette logique. La mise en œuvre des grands principes de la citoyenneté républicaine entraîna la suppression des passeports intérieurs et des livrets ouvriers car un citoyen devait pouvoir circuler sans entrave sur l’ensemble du territoire national. De même, tous les Français purent désormais bénéficier des mêmes droits en matière de secours, de travail, etc.
Pour intéresser les classes populaires à des questions politiques abstraites, les journalistes durent les « traduire » dans un langage susceptible de mobiliser les émotions des lecteurs.
Dans le même temps, le pouvoir républicain imposa des mesures décisives pour démocratiser la vie politique française : la liberté de la presse et les lois scolaires furent justifiées par la volonté de faire participer tous les citoyens à la vie politique de la nation. En quelques années, ce processus d’intégration des classes populaires au sein de l’État-nation provoqua un profond bouleversement de la vie publique. C’est ce changement de paradigme qui entraîna l’irruption brutale du thème de « l’immigration » dans le débat politique. Le mot lui-même, rarement utilisé auparavant, s’imposa dans le vocabulaire courant. La IIIe République poussa jusqu’à son terme le processus de « nationalisation » de la société française entamé en 1789 ; ce qui eut pour effet d’institutionnaliser le clivage entre Français et étrangers. Ce n’est donc pas un hasard si la première grande loi sur la nationalité française, celle qui régit toujours notre « identité nationale », fut adoptée en 1889 après plusieurs années de débats acharnés. En droit, la nationalité désigne en effet l’appartenance à la population d’un État et celui-ci doit avant tout protéger ses ressortissants. C’est un point sur lequel Norbert Elias a beaucoup insisté en disant que l’État national était devenu à partir de cette époque « l’unité élémentaire de survie » pour tous les citoyens, en remplacement des anciennes communautés locales.
Les lois républicaines sur la presse et sur l’école impulsèrent un formidable développement de la communication écrite. La conquête de ce nouveau marché que représentaient les millions de paysans et d’ouvriers capables désormais de lire le journal aboutit au triomphe de la presse de masse, dominée par quelques grands quotidiens qui imposèrent chaque jour les sujets définissant ce qu’on appelle « l’actualité ». Ces organes de presse permirent aux classes populaires d’élargir leur horizon, mais pour les intéresser à des questions politiques abstraites, sur lesquelles elles n’avaient pratiquement aucune prise, les journalistes durent les « traduire » dans un langage susceptible de mobiliser les émotions des lecteurs. C’est ainsi que se développa ce que j’appelle, après Pierre Bourdieu, la « fait diversion » de la politique. Les acteurs réels du monde social furent alors transformés en personnages réduits à une seule dimension de leur identité. Cette mise en récit permit aux lecteurs de tous les milieux de se familiariser avec les grands événements de politique internationale, en s’identifiant au personnage du « Français », tantôt victime des agresseurs étrangers (surtout Allemands), tantôt héros répandant au péril de sa vie les bienfaits de la civilisation dans des contrées barbares peuplées de sauvages.
Il faut souligner que cette « fait diversion » de la politique fut aussi un moyen de promouvoir une nouvelle figure du populaire : celle de l’ouvrier victime des accidents du travail, mitraillé par l’armée quand il manifeste dans la rue. Ces événements violents et spectaculaires furent largement relayés eux aussi par la grande presse. Le récit de faits divers mettant en scène des victimes et des agresseurs servit ainsi de matrice pour les deux grands types de discours politiques qui s’affrontèrent dès la fin du XIXe siècle. La droite et l’extrême droite politisèrent l’appartenance nationale fondée sur le clivage Français/étrangers, alors que la gauche et l’extrême gauche privilégièrent l’appartenance sociale fondée sur le clivage ouvriers/patrons.
Toutes les polémiques sans cesse reprises jusqu’aujourd’hui s’imposèrent alors en quelques années dans le débat politique.
C’est dans ce nouveau contexte, très rapidement brossé ici, que la question de l’immigration surgit brutalement comme « problème » dans l’espace public. Au départ, ce furent des députés radicaux (appartenant à la gauche du parti républicain) qui s’en emparèrent en dénonçant le laxisme du gouvernement. Dès le début des années 1880, la première grande crise du capitalisme (qu’on appelle la Grande Dépression) provoqua en effet un rejet de la politique libérale menée jusque-là par le pouvoir républicain. En complément des mesures protectionnistes visant les marchandises (droits de douane), les radicaux réclamèrent une protection du marché du travail. On découvrit à ce moment-là que les travailleurs étrangers entraient et sortaient librement du territoire national, qu’ils n’étaient enregistrés nulle part, et qu’il n’y avait pas de statistiques fiables par nationalité. Toutes les polémiques sans cesse reprises jusqu’aujourd’hui, concernant l’envahissement des étrangers « clandestins », les problèmes d’intégration (qu’on appelait à l’époque « assimilation »), le danger « communautariste » (les Juifs et les Italiens étant accusés de former « une nation dans la nation »), s’imposèrent alors en quelques années dans le débat politique.
Cette question prit une importance particulière en France car dès cette époque l’immigration était devenue une nécessité pour assurer le développement industriel du pays. Mais ceux qu’on avait fait venir en toute hâte pour occuper les emplois désertés par les nationaux furent dénoncés comme les responsables du chômage dès que la conjoncture se retourna.
L’Affaire Dreyfus acheva de restructurer le champ politique français autour du clivage opposant la droite nationale-sécuritaire et la gauche sociale-humanitaire. Toutefois les socialistes qui défendaient des positions internationalistes durent constamment affronter les propos et les actes xénophobes d’une partie des classes populaires. Les rixes entre travailleurs français et étrangers furent fréquentes à cette époque, et complaisamment relayées par la grande presse. L’expulsion manu militari de plus d’un millier de mineurs belges dans le Pas-de-Calais en 1892 et le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893 furent des illustrations majeures de ce rejet, plaçant les élus socialistes dans une position d’autant plus difficile que le patronat recruta fréquemment des travailleurs immigrés pour faire pression sur les salaires ou pour briser les grèves.
Chaque fois que les conflits entre les États nationaux s’exacerbèrent, l’appartenance nationale l’emporta sur l’appartenance sociale.
En contradiction avec les grands principes internationalistes affichés par le mouvement ouvrier, Alexandre Millerand, le premier socialiste ayant accepté de participer à un gouvernement « bourgeois », fit adopter un décret (en 1899) imposant des quotas d’ouvriers étrangers dans les entreprises de travaux publics travaillant pour le compte de l’État. En 1914, dans tous les pays en guerre, les partis socialistes rallièrent l’Union sacrée, consacrant la faillite de la IIe Internationale.
La gauche fut donc dans l’incapacité de rester fidèle au fameux slogan que Marx et Engels avaient proclamé dans la conclusion du Manifeste du Parti communiste : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». La raison majeure de cet échec tient au fait que dans les dernières décennies du siècle, les classes sociales furent, elles aussi, profondément affectées par le processus de nationalisation des sociétés européennes. En conséquence, chaque fois que les conflits entre les États nationaux s’exacerbèrent, l’appartenance nationale l’emporta sur l’appartenance sociale.
Ce clivage entre le national et le social perdura tout au long du XXe siècle, avec une force particulière dans le cas français, parce que le monde ouvrier fut constamment renouvelé et facturé par l’immigration. Au sein de la gauche, les partis les plus intégrés dans l’État eurent tendance à privilégier les intérêts des travailleurs nationaux au détriment des étrangers. Ce fut le cas de la SFIO dans l’entre-deux-guerres. Mais le Parti communiste, qui avait pris en compte les intérêts des travailleurs étrangers et coloniaux avant le Front Populaire, évolua de la même façon que la SFIO, après la seconde guerre mondiale, se montrant incapable d’accueillir en son sein le prolétariat issu de l’immigration post-coloniale. Pourtant, force est de constater que la gauche est parvenue à conquérir le pouvoir d’État quand les partis se réclamant du mouvement ouvrier ont réussi à s’allier aux forces qui défendaient les droits humains. Ce fut le cas en 1902, avec le Bloc des gauches, en 1936 avec le Front Populaire et en 1981 avec l’union de la gauche.
Une rupture d’une ampleur comparable à celle qui s’était produite un siècle plus tôt a eu lieu dans les années 1980. Le retour en force du capitalisme libéral, illustré par la délocalisation massive des entreprises industrielles vers les pays à bas salaire, a provoqué une crise profonde du mouvement ouvrier. Plus globalement, c’est toute la « démocratie de partis » qui a cédé la place à la « démocratie du public » pour reprendre les termes de Bernard Manin. Certes les partis politiques n’ont pas disparu, mais ils ont perdu une bonne partie de l’autonomie dont ils disposaient auparavant par rapport au champ journalistique.
Le drame des réfugiés fuyant les violences politiques a été exploité par les partis de droite et d’extrême droite car la xénophobie reste un fonds de commerce politiquement rentable.
C’est dans ce cadre nouveau, qu’a ressurgi la question de l’immigration. La démocratie du public a favorisé le retour au premier plan d’une extrême droite que la majorité des citoyens ne voient plus désormais comme un danger parce qu’elle ne prône plus explicitement la révolution, et qu’elle prétend même défendre les « valeurs de la République ». L’extrême droite des années 1980 s’est d’abord imposée sur la scène médiatique, grâce aux fortes audiences de Jean-Marie Le Pen à la télévision. Sa capacité à faire scandale en multipliant des propos qu’on pensait révolus depuis la fin du régime de Vichy a séduit des téléspectateurs/électeurs aspirant à une rupture profonde avec l’ordre établi mais qui se sentent abandonnés par les autres partis politiques. Même s’il faut constamment rappeler que le premier parti des ouvriers, c’est l’abstention, il est vrai que le Front national a pu ainsi récupérer à son profit la fonction tribunicienne qui était auparavant accaparée par le PCF.
Les socialistes au pouvoir se sont adaptés à cette nouvelle donne à partir de 1983-84 en élaborant un nouveau discours sur l’immigration, délaissant la question sociale pour des thèmes identitaires. L’expression « travailleur immigré » – qui avait été forgée par le Parti communiste dans l’entre-deux-guerres, puis réactivée par les militants d’extrême gauche en 68 et dans les années suivantes – disparaît alors du vocabulaire socialiste, remplacée par des termes ethniques comme le mot « beur » censé désigner « les jeunes issus de l’immigration maghrébine ». Les grèves menées par les OS immigrés dans l’automobile sont dénoncées par le Premier ministre Pierre Mauroy comme des entreprises téléguidées depuis l’Iran par l’ayatollah Khomeyni. Les travailleurs immigrés, l’entreprise et l’usine disparaissent alors du discours de la gauche de gouvernement au profit de la « deuxième génération », des cultures d’origine et des quartiers sensibles. En se repositionnant sur le terrain identitaire, au détriment des questions sociales, la gauche a certes mené un combat important et nécessaire contre les discriminations et le racisme ; mais elle a perdu la bataille politique car la multiplication des actes terroristes menés par des fanatiques se réclamant de l’islam a conforté les discours islamophobes ; le « mauvais beur » s’est imposé dans l’opinion contre les slogans identitaires du type « black, blanc, beur ».
Les polémiques actuelles sur les « migrants » illustrent un énième épisode de cette histoire longue de l’immigration. La différence avec les précédents tient au fait que l’État national français a perdu une partie de sa souveraineté dans le contrôle des frontières avec l’intégration au sein de l’Union européenne. Autre différence : alors que la France avait été constamment un grand pays d’immigration depuis le Second Empire, ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisque selon l’OCDE elle se situe au 17e rang des pays développés pour le taux d’immigrés dans la population totale. Le drame des réfugiés fuyant les violences politiques en Syrie et ailleurs a été exploité par les partis de droite et d’extrême droite car la xénophobie reste un fonds de commerce politiquement rentable. Ceux qui, à gauche, ont les yeux rivés sur les sondages et les « cotes de popularité » auraient toutefois tort de se laisser séduire par le chant de ces sirènes-là, car l’histoire montre que c’est toujours un mauvais calcul.
