Des ronds-points et de la condition périurbaine
Si l’on voulait écrire des Mythologies à la Roland Barthes au sujet des « gilets jaunes », il faudrait consacrer un texte au rond-point ; emblématique d’un aménagement routier fonctionnaliste, chéri des ingénieurs spécialistes des réseaux routiers car il fluidifie les trafics aux intersections, il s’est imposé partout en quelques décennies à mesure que la périurbanisation et la voiture individuelle affirmaient leur empire. Cet objet anodin et banal est pourtant devenu pendant quelques semaines un lieu névralgique où le mécontentement social se « précipitait » – au sens de la chimie. Ainsi, en peu de jours, une nouvelle géopolitique a émergé au sein du territoire national.
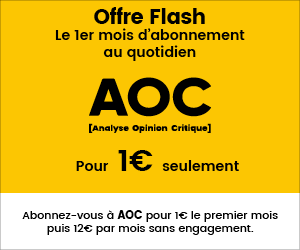
Les « gilets jaunes » habitent le périurbain diffus, ils en connaissent les forces et les faiblesses. Tous automobilistes, ils savent d’expérience, parce qu’ils le vivent quotidiennement, qu’un rond-point est un connecteur qui permet de commuter entre les différents espaces qu’il joint et, surtout, qui assure l’accès à toutes les implantations périphériques devenues indispensables aux fonctionnements urbains : centres commerciaux, zones d’activités, grands agrégats d’entrepôts logistiques, parcs de loisirs, équipements touristiques et de sports, cliniques privées, on n’en finirait pas de dresser la liste de tout ce qui a migré autour des centres des agglomérations depuis la fin des années 1960. Une bonne partie de la production de valeur ajoutée des aires urbaines se trouve désormais dans ces archipels d’activités en périphérie, qui génèrent chaque jour des flux considérables.
Tenir les ronds-points et les transformer en places fortes, contrôler ainsi les rocades et les entrées d’autoroutes, c’était donc viser juste, frapper le système territorial là où il est en vérité le plus vulnérable. D’ailleurs, vouloir investir les centres a été la principale erreur des « gilets jaunes », car cela les a sortis de leur terrain d’élection : emportés par « le soutien des Français », selon les sondages d’opinio
