La métamorphose de l’ordre politique : de la société civile aux pratiques politiques autonomes
Insurrection civile en Algérie ; grèves lycéennes pour le changement climatique en Europe ; énième acte des Gilets Jaunes en France ; élections de Zuzana Caputova à la Présidence de la Slovaquie et de Volodymir Zelenski à celle de l’Ukraine ; manifestations contre la corruption en Roumanie et Bulgarie ; révolte populaire et destitution d’Omar-el-Béchir au Soudan ; blocage du centre de Londres et occupations des tours de la Défense à Paris par les activistes de l’environnement.
Les semaines passent et confortent l’idée qu’un changement d’attitude s’enracine : les citoyen.ne.s se gênent de moins en moins pour faire irruption dans la vie politique d’un pays afin d’imposer, à leur propre initiative, une orientation nouvelle à la manière dont les affaires publiques y sont prises en charge par leur gouvernement et les partis qui le soutiennent.
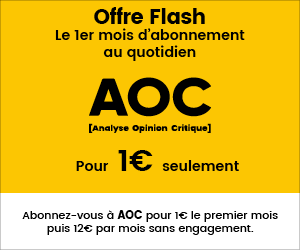
Autrement dit, la « souveraineté du peuple » ne se construit plus uniquement dans les urnes. Elle prend consistance désormais lorsque des foules prennent la rue pour s’opposer à des pouvoirs discrédités (en parvenant parfois à les chasser de façon pacifique) ; lorsque des ONG, des collectifs ou des associations obligent des gouvernements à négocier, les assignent en justice ou les font revenir sur des mesures inacceptables ; lorsque le recours à la désobéissance civile, à l’action directe non-violente ou à des occupations aide à satisfaire une revendication ; lorsque des « mouvements » se situant hors du système des partis gagnent des sièges dans un Parlement ou décident de former un exécutif ; ou lorsque des novices en politique sont portés à la tête d’un État contre les candidats de l’establishment.
En dépit de ses indiscutables succès, cet activisme « sauvage » continue à être envisagé comme dénué de toute valeur politique au motif qu’il se situe aux marges du cadre convenu des institutions de la représentation. Et lorsqu’elle est qualifiée de « populiste » ou d’ « anti-système », cette façon d’agir en politique est décrite com
