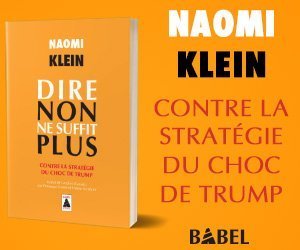L’éducation sous contrôle – sur le projet de « code de justice pénale des mineurs »
La hausse récente du nombre de mineurs incarcérés[1] montre que l’équilibre instable du traitement pénal des mineurs, mis en tension entre ses visées éducatives et ses usages sécuritaires, risque toujours, sur fond de pénalisation des problèmes sociaux, de pencher vers les seconds. Cette tendance, que les chercheurs en sciences sociales saisissent sous l’angle d’un « virage punitif », inquiète depuis plus de deux décennies les principaux acteurs de la justice des mineurs, des juges des enfants aux personnels chargés d’en exécuter les décisions, dans le secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse ou dans le secteur associatif habilité à intervenir à titre pénal.
C’est dans ce contexte que se multiplient, depuis une dizaine d’années, les appels à une réécriture du droit pénal des mineurs. Dernier en date : le 13 juin 2019, la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a annoncé une réforme qui sonnera le glas de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, au profit d’un nouveau « code de justice pénale des mineurs ». Ce projet de réécriture est tout sauf une surprise. Dès 2008, le rapport de la commission Varinard, remis à la Garde des Sceaux d’alors, Rachida Dati, s’attaquait à ce « texte quasi mythique », selon les mots utilisés par son président, André Varinard, à l’occasion du discours de remise du rapport. L’écriture d’un nouveau « code », objet des six premières propositions du rapport, visait déjà, à l’époque, à « assurer une meilleure lisibilité des dispositions applicables aux mineurs ».
Derrière la lisibilité, la philosophie
Réformée plus d’une quarantaine de fois depuis 1995, l’ordonnance de 1945 n’a de fait plus grand chose à voir avec le texte d’origine. Le juriste Christophe Daadouch souligne néanmoins que si « le texte est complexe car composé d’un mille-feuille de dispositions votées par à-coups », corroborant l’argument d’illisibilité, « sa philosophie reste aujourd’hui d’actualité[2] ». Cette « philosophie » r