La gauche et le progressisme : du pléonasme à l’oxymore
La gauche est née en France (et, à sa suite, dans le Monde) par la répartition topologique des délégués aux États généraux de 1789 : ceux qui siègent à gauche se réclament des Lumières, de la république (état de droit, séparation des pouvoirs, libertés civiles), de l’amélioration des conditions d’existence de tous et d’un mouvement vers la démocratie représentative, comme projet volontaire, historique et ouvert.
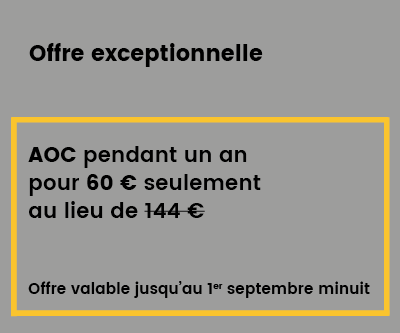
Les Lumières supposent acquise l’idée de progrès, c’est-à-dire le fait que l’évolution des humains vers une situation meilleure que l’actuelle est possible et qu’elle est le résultat d’une action des humains eux-mêmes [1]. Face à ce courant, on trouve ceux qui, soit refusent tout changement parce qu’ils pensent le mouvement vers le mieux impossible ou illégitime (conservatisme), ou ceux qui considère que les transformations ne peuvent procéder d’un mouvement des citoyens ordinaires, mais d’acteurs individuels ou collectifs surplombants (despotisme). Gauche et progressisme sont donc, au départ, synonymes.
Gauche et mouvement ouvrier : forces et faiblesses d’une alliance stratégique
Pourtant, un demi-siècle plus tard, quelque chose bascule. Dans la mémoire historique française, tout se joue aux alentours de 1848, on pourrait même dire entre février et juin. D’un côté, la gauche (qu’on appelle alors les « libéraux ») demandent l’avènement d’une république démocratique, au sein de laquelle la « question sociale » est légitime, de l’autre, le mouvement ouvrier naissant réclame la désexclusion urgente d’un prolétariat surexploité. A priori, rien de contradictoire, il suffirait d’ajouter « sociale » à démocratie, et c’est ce qui pousse une grande partie de la gauche à s’allier aux associations ouvrières.
Sauf que… dans la pensée de Karl Marx et de ses amis, qui finissent par occuper l’axe central du mouvement ouvrier européen, la « classe ouvrière » ne doit pas se voir comme une composante du courant progressiste mais viser à sa propre libération en se séparant de
