PMA avec tiers donneur : Quelle modalité d’établissement de la filiation ? (1/2)
Trois possibilités sont aujourd’hui en discussion[1] pour l’établissement de la filiation des enfants conçus par don. La première consiste à maintenir la filiation charnelle (titre VII du code civil) pour les couples de sexes différents, et instituer une filiation spécifique pour les couples de femmes par présomption de co-maternité et /ou reconnaissance supposant pour ces couples de fonder la filiation sur le consentement au don. Une solution qui ne figurait pas dans le pré-projet du gouvernement. Elle est préconisée par diverses associations.
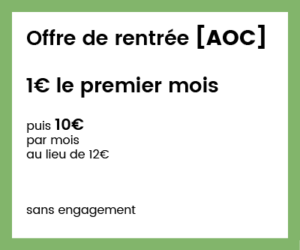
La seconde éventualité serait d’instituer entre la filiation charnelle (titre VII) et la filiation adoptive (titre VIII), une troisième modalité d’établissement de la filiation, la « filiation par déclaration anticipée de volonté » inscrite dans un titre VII bis. Cette filiation fondée sur l’engagement parental serait destinée à tous les parents recourant à un tiers donneur. Cette solution était une option retenue dans le pré-projet du gouvernement (article 4) mais elle ne figure pas dans le projet de loi. Elle aussi est soutenue par diverses associations.
Enfin la possibilité de maintenir la filiation charnelle (titre VII) actuellement en vigueur pour les couples de sexe différent et instituer une « filiation par déclaration anticipée de volonté » pour les seuls couples de femmes, inscrite dans un nouveau titre VII bis. C’était l’une des deux options envisagées dans le pré-projet du gouvernement (art. 4bis). Préconisée par le Conseil d’État, c’est la solution inscrite dans le projet de loi.
Pour comprendre ces enjeux, il est nécessaire de rappeler la situation actuelle en expliquant pourquoi on ne peut pas utiliser l’expression « droit commun de la filiation » pour désigner la filiation charnelle du titre VII, et de préciser les origines et raisons d’être de cette filiation.
La situation actuelle en cas de don : filiation charnelle titre VII du code civil (et non « de droit commun »)
Pour asseoir correctement la discussion,
