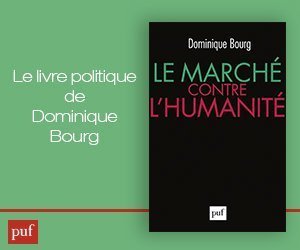Inégalités : quand la famille s’en mêle
La montée des inégalités de revenus comme de patrimoine dans la plupart des pays a conduit de nombreux chercheurs à en analyser les causes. Parmi les déterminants mis en avant, on retrouve le plus souvent des facteurs macroéconomiques – progrès technique, mondialisation, financiarisation de l’économie – ou institutionnels – fiscalité, régulation du marché du travail. Le changement dans la nature des inégalités, notamment en France, invite à compléter la liste des déterminants en y ajoutant la famille qui joue un rôle essentiel dans les évolutions récentes des inégalités.
Premièrement, le retour de l’héritage replace au centre du jeu la famille comme vecteur de reproduction des inégalités. Alors que les héritages et donations constituaient seulement un tiers du patrimoine total des ménages français dans les années 1970, ils en représentent aujourd’hui presque deux tiers. Plus important, ce retour de l’héritage ne profite pas à tous puisque près de la moitié de la population n’hérite de rien ou presque quand, à l’autre bout de l’échelle, une part croissante de Français reçoit davantage en héritages et donations que d’autres en toute une vie de travail. Dans ce type de société, l’origine familiale a donc un pouvoir explicatif bien plus fort que le mérite individuel.
Sans surprise, les transmissions entre parents et enfants sont le moteur principal de ces inégalités puisque la famille nucléaire concentre plus de 85% de l’ensemble des transmissions. Cependant, les nouvelles formes familiales, en tête desquelles les familles recomposées, invitent à repenser ces transmissions. La fiscalité successorale confère le statut d’héritier aux seuls enfants biologiques et rend couteuses les transmissions aux enfants d’un conjoint[1]. De la même manière, une part croissante de Français décède sans enfant et font face à taux d’imposition très élevés. Cette dernière évolution explique d’ailleurs en partie la stabilité des recettes de l’impôt successoral malgré un déclin de