La gauche et les siens : contexte (1/3)
Deux ans après la présidentielle, les dernières élections européennes ont conforté la thèse d’un partage du champ politique entre progressistes autoproclamés et nationalistes assumés. Les uns promettent de rendre la France plus compétitive en déverrouillant la société, les autres d’ériger la nation en rempart contre les effets corrosifs de la mondialisation.
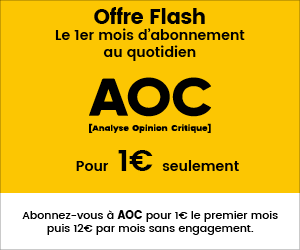
L’essor de cette alternative inédite se traduit par l’effondrement des deux anciens partis de gouvernement – d’abord le Parti socialiste, ensuite Les Républicains – mais aussi par les réticences des principaux réfractaires au duopole formé par la République en Marche et le Rassemblement national – la France Insoumise hier, Europe Écologie les Verts aujourd’hui – à se référer au vénérable affrontement de la droite et de la gauche.
Le paysage électoral apparaît pourtant sous un jour bien différent lorsqu’on délaisse le point de vue de l’offre pour celui de la demande. Loin d’entériner l’avènement d’un face à face entre détracteurs des populismes et contempteurs du mondialisme, les citoyens qui continuent de se rendre aux urnes se divisent en trois groupes de tailles à peu près équivalentes.
Le premier, qui reconnaît le bien-fondé de la préférence nationale, accorde ses faveurs au Rassemblement pareillement nommé. Le deuxième, qui déplore le matraquage fiscal et les corporatismes, se range derrière les avocats de la rigueur budgétaire et de la flexibilité des conditions d’emploi. Enfin le troisième, qui juge intolérable de transiger avec la solidarité, l’hospitalité, les libertés civiles et la transition énergétique, éparpille ses suffrages entre les formations sensibles à ses préoccupations. Pour le dire simplement, l’électorat se répartit à peu près également entre l’extrême droite, la droite dite néolibérale et la gauche.
Le mythe du vote protestataire
La tripartition de la demande politique est avérée depuis longtemps. Cependant, rares sont les commentateurs qui s’appuient sur elle pour formuler leurs analyses
