Partager l’intime
L’intime n’existe, semble-t-il, que dans l’horizon de sa perte. Les diagnostics ne manquent pas, ni les prophéties, qui annoncent sa disparition à plus ou moins brève échéance. On discute pour savoir si l’intime est mis en danger du fait de sa valorisation elle-même, par exemple au travers des mises en scène de soi et de ses sentiments auxquelles sont invités les individus. Ou, au contraire, s’il n’est pas victime de sociétés de la transparence qui n’accordent plus aucune place au secret. On se demande si l’intime ploie sous le narcissisme de l’individu contemporain ou s’il ne succomberait pas plutôt devant l’effacement de l’individualité au profit d’un monde impersonnel fait de réseaux. Les prétendants au titre de prédateurs de l’intime ne manquent pas non plus : nouvelles technologies, exhibitionnisme libéral, marchandisation de toutes les sphères de l’existence, désir d’être reconnu, triomphe de l’image, etc.
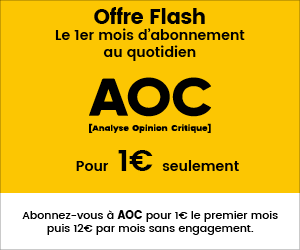
Les diagnostics sur la disparition de l’intime pèchent presque toujours par leur excès de généralité. Mais il vaut la peine d’être attentifs à ce qui les fonde, et qui reste vrai quel que soit leur degré d’exactitude sociologique : l’intime est indissociable d’une fragilité qui le met en péril. La possibilité d’entretenir des relations, de fonder des liens ou de forger des expériences à l’abri du jugement social n’est jamais acquise, elle résulte plutôt d’une conquête qui rencontre des obstacles. Avant de déterminer quels sont ces obstacles, et pour pouvoir le faire, il faut essayer de comprendre d’où vient cette fragilité essentielle.
À première vue, la chose semble facile à expliquer : l’intime est fragile du seul fait qu’il réclame de demeurer caché. Sa simple monstration équivaudrait à sa négation puisqu’il est dans la nature de l’intime de se soustraire aux regards. Dans une telle perspective, l’intime ne pourrait être préservé qu’en demeurant voilé, tu, imperceptible. On conçoit aisément, alors, ce qui le rend fragile dans des sociétés comme les nôtres, qui valorisent la communication et instituent la publicité en critère de ce qui est légitime[1]. À ce compte, c’est toute société, autrement dit c’est le fait social comme tel, qui fragiliserait l’intime au point de le rendre impossible. Considérer que l’intime échappe par principe à toute visibilité interdit de comprendre comment il est devenu un enjeu politique précisément dans les sociétés modernes animées par l’exigence de publicité.
Les luttes féministes et les revendications des minorités sexuelles rencontrent souvent l’opposition de certains fidèles qui réclament la reconnaissance publique de leur foi. Des désirs intimes jouent ici contre des croyances religieuses de même nature. Mais, dans tous les cas, c’est bien d’une politisation de l’intime qu’il s’agit : celle-ci implique l’accès de ce qui est personnel à la visibilité publique. À ce titre déjà, le rapport entre l’intime et le caché doit être dialectisé : pour accéder à une forme de tolérance sociale, il faut d’abord que l’intime paraisse sur la scène.
Cette manifestation de l’intime prend des formes variées qui vont d’une revendication militante affirmative à la mise en lumière de souffrances jusque-là inaperçues. La vivacité des réactions qui ont entouré le phénomène « Me Too » montre la diversité des jugements portés sur cette manifestation de l’intime, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre sous la lumière des violences passées jusque-là sous silence. Le harcèlement sexuel dont sont victimes nombre de femmes n’appartient pas à un intime choisi, mais à une intimité contrainte que certaines d’entre elles ont décidé de rendre publique.
Les jugements portés sur cette publication dans les réseaux sociaux participent eux-mêmes de la dialectique suivant laquelle, pour pouvoir être vécus à l’abri des hiérarchies sociales, les liens intimes doivent d’abord être revendiqués et discutés sur la place publique. Dans des sociétés démocratiques, le secret n’est pas une donnée absolue de l’intime : il suppose d’être provisoirement mis en suspens afin de ne plus servir de prétexte aux injustices.
Ce qui est vrai de la politisation de l’intime, l’est aussi de son essence psychologique. Comme l’a montré Lacan, l’intime désigne moins l’autre de l’« extime », que son expression nécessaire : « L’intime n’est pas l’image que l’on se fait de l’intérieur. Ce n’est pas ce qui se passe à l’intérieur mais c’est exactement ce qui constitue le rapport à l’autre, dans le langage ». Cette différence entre l’intime et une intériorité muette et invisible se manifeste par exemple dans le « cri ». Que celui-ci soit de douleur ou de plaisir, il porte à la perception de tous les présents ce qu’il y a de plus profondément caché dans le sujet. L’intime est en retrait, certes, mais comme la douleur ou le plaisir sont en retrait du cri « extime » qui les manifestent. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a pas davantage dans l’intérieur que dans son extériorisation puisque c’est toujours par un langage plus ou moins articulé que l’intime atteste son existence.
Ce langage désigne une adresse à un autre : il faut partir de là pour élaborer une hypothèse sur la fragilité de l’intime. Le problème réside moins dans la manifestation de l’intime en général que dans des formes de visibilité qui le dénaturent. Pour explorer cette piste, je m’appuierai sur la notion de partage. Que l’intime puisse faire l’objet d’un partage ou, pour mieux dire, qu’il soit le lieu paradoxal d’un partage, c’est ce que montrera une brève généalogie de ce concept. Trop souvent confondu avec le « privé », l’intime désigne moins une réalité individuelle qu’une modalité spécifique de la relation.
Celle-ci exclut certainement d’être partagée avec tous : le partage intime s’effectue entre des êtres qui entendent ne pas voir exposés leurs désirs à tous vents. Mais, loin d’exclure tout regard, l’intime réclame un certain type d’accueil qui, à son tour, implique sa manifestation. Sur la base de ces rappels, il faudra se demander ce qui, particulièrement dans les sociétés contemporaines, porte les sujets à étendre indéfiniment le partage de ce qui leur est intime. J’essaierai de montrer que c’est un doute sur la réalité de ce qui est intime qui incite les sujets à un partage indéfini, le regard des autres étant interprété comme une authentification des liens qui leur sont le plus personnels. La fragilité spécifiquement contemporaine de l’intime s’expliquerait moins, alors, par un goût pour la transparence que par une incertitude sur la réalité de nos expériences subjectives.
Deux énoncés théologiques
Le mot « intime » fait son entrée dans le vocabulaire philosophique avec Augustin. Le terme apparaît dans le livre VIII des Confessions où il décrit Dieu comme « interior intimo meo[2] ». La charge de ce comparatif accolé à un superlatif (Dieu est « plus intérieur que ce que j’ai de plus intime ») est polémique : Augustin argumente contre les doctrines manichéennes qu’il a épousées pendant sa jeunesse, et selon lesquelles Dieu serait semblable à une chose extérieure à la conscience. Le divin longtemps recherché en dehors de lui-même (dans la splendeur des astres ou dans les beautés du monde), Augustin le découvre à la place qu’il assignait jusque-là à son âme : celle du centre. Dans ce texte, Dieu ne fait pas l’objet d’une intériorisation car cela supposerait que l’intériorité préexiste à ce qui, en elle, est le plus profond. C’est bien plutôt « au lieu du soi » que Dieu se loge, comme un démenti à toutes les tentatives du sujet pour revendiquer son autosuffisance.
De ce contexte polémique, on peut retenir que si l’intime fait signe vers une certaine intériorité, celle-ci est de nature relationnelle. L’intime ne désigne pas l’intimité de la conscience à elle-même, son autarcie, mais au contraire le fait qu’un autre est plus proche de moi-même que je ne le suis dans la solitude. Si l’on se réfère à l’énoncé d’Augustin, l’aveu de fragilité se trouve dans le fait que l’intime, puisqu’il désigne d’abord une relation, dépend au moins partiellement de la volonté du sujet. Il faut accepter d’entrer dans une relation intime, en l’occurrence il faut admettre qu’un être (Dieu) possède sur moi-même une vérité à laquelle je ne peux prétendre par mes propres moyens.
Augustin nomme « amour » cette emprise, un amour qui ne se sépare jamais d’une forme de connaissance. C’est là un aspect que la modernité conservera : quelle soit amoureuse, amicale ou désirante, une relation intime réunit le sentiment et le savoir. Je dis d’un être qu’il est un de mes « intimes » à partir du moment où je lui concède le droit de porter sur moi une parole vraie. Dans le dispositif d’Augustin cette emprise de l’autre peut être refusée par le sujet. Les tribulations du futur évêque de Carthage avant sa conversion attestent cette fragilité. La foi en un Dieu intime suppose l’abandon d’un orgueil qui consiste, pour l’individu, à se considérer comme le centre de toute chose et à refuser la parole d’un autre dans la constitution de sa propre identité.
À cette première contrainte s’en ajoute une seconde qui ne vaut pas pour Augustin, mais pour nous qui héritons d’un concept sécularisé de l’intime. Dans un contexte religieux, le doute sur la bienveillance de l’Autre intérieur n’est pas permis. Pour le dire plus exactement : l’amour de Dieu est aussi inconditionnel qu’est certaine la connaissance qu’Il possède du fidèle. Selon Augustin, Dieu peut être dit « intime » car 1/ Il est détenteur d’une vérité sur sa créature que cette même créature ignore et 2/ qu’Il est disposé à la lui révéler. Dans un horizon théologique, ces deux aspects ne font pas question. Cette clause de sûreté disparaît en revanche de la définition moderne de l’intime. Celui-ci ne dépend plus de l’acceptation d’un lien avec la transcendance, il est soumis à la contingence des sentiments humains. Désormais, le sujet « élit » des êtres auxquels il accorde le bénéfice de la véracité, et non plus de la vérité. Ce dessaisissement au profit d’un autre est opéré à ses risques et périls, sans certitude sur le caractère réciproque des liens ainsi élaborés.
Il y a évidemment un rapport entre les deux fondements de la fragilité de l’intime. Le refus d’entrer dans des relations intimes (fondement structurel) s’augmente d’un doute (fondement moderne) sur la bienveillance de l’autre. Dans ce domaine, les portraits de l’homme contemporain en cynique incapable de s’abandonner au désir ou à l’amour par peur d’être trahi font système avec la figure du « pervers narcissique » toujours à la recherche d’une victime dont il pourrait profaner l’intimité. Il existe des pathologies de l’intime proportionnelles à la valorisation sociale dont cette notion fait l’objet.
Plutôt que d’aborder la question de la possibilité de l’intime dans les sociétés modernes par des voies psychosociologiques, je préfère mettre la formule d’Augustin en regard d’un autre énoncé emprunté à la théologie spéculative. Au début du XVIIIe siècle, l’évêque Berkeley résume la portée de son idéalisme radical dans la formule esse est percipi aut percipere (« être, c’est être perçu ou percevoir »). À première vue, cet énoncé ne dit rien de l’intime, il appartient à une théorie de la connaissance qui aboutit à une thèse immatérialiste. Berkeley conclut de sa critique sans concession des idées générales (rien de tel que « le » triangle n’existe, seul existe tel ou tel triangle auquel je pense actuellement) que les choses n’ont d’effectivité que pour autant, et pour autant de temps, qu’un sujet se les représente. L’existence de l’arbre que je vois est hors de doute, mais rien ne me garantit que cette existence précède ma vision présente ou qu’elle se prolonge après elle. La matière ne possède aucune indépendance par rapport à la perception dont elle fait l’objet par un esprit. Autant dire que la matière n’existe pas : seules existent des représentations des choses matérielles, autrement dit des idées.
De ce doute radical sur l’existence des choses matérielles extérieures, Berkeley tire une série de conséquences épistémologiques qui n’intéressent pas notre sujet. Seule une de ses conclusions permet de retrouver la question de l’intime, et elle est de nature métaphysique. Si l’être dépend de la perception actuelle des choses, qu’est-ce qui garantit la permanence du monde ? Pour Berkeley, la réponse à cette question ne fait guère de doute : le fondement de la réalité des choses se trouve précisément dans le Dieu d’Augustin « interior intimo meo ». De fait, si une chose n’existe qu’à condition d’être représentée (si, donc, elle n’existe qu’en tant qu’idée), alors la nature entière se soutient d’être une idée divine. Dieu figure ici le spectateur permanent du monde, le grand Sujet Percevant dont le regard assure une réalité idéale, mais permanente, à une existence dont les sujets finis ne peuvent s’assurer que par éclipse. Dieu coordonne les esprits finis de telle sorte que, en dépit des aléas de la perception, ils se rapportent au même monde et peuvent coordonner leurs actions sur la base de cette identité. Les choses qu’un sujet humain ne perçoit pas en un temps déterminé existent néanmoins comme une idée divine, au titre d’une représentation immatérielle, mais certaine.
Dans ce schéma, l’intimité de Dieu à la conscience fonctionne comme le seul fondement possible de l’existence du monde. D’où la question : que se produit-il lorsqu’un doute s’insinue à propos de cette intimité ? Dans la modernité, on l’a dit, une relation intime ne reçoit plus de garantie absolue : la confiance qu’un sujet accorde à un être dépend de dispositions, d’attitudes ou de sentiments immaîtrisables. De là, le spectre de la trahison intime. La thèse de Berkeley qui assimile l’existence à la perception complique encore la donne. Si je ne peux m’assurer de l’existence d’un lien intime, comme de toute autre chose, qu’en me la représentant, la tentation devient forte de multiplier l’émission de signes, de traces ou d’images qui attestent la réalité de ce lien. En l’absence d’un grand Sujet Percevant, juge de la réalité des sentiments et de la sincérité des cœurs, que reste-t-il à l’individu sinon la possibilité de manifester aux autres, en droit à tous les autres, ce qui n’a pourtant de consistance qu’à demeurer partiellement caché ? C’est cette hypothèse en forme de paradoxe que je souhaiterais désormais explorer.
L’intime et sa représentation
Convoquer une thèse métaphysique afin d’étayer un diagnostic sur le statut de l’intime dans les sociétés contemporaines peut paraître décalé. Pourtant, la fragilité spécifiquement moderne de l’intime renvoie à son existence. Dès lors que l’autre intime n’est plus un Dieu, mais un être humain, la question de confiance se pose inévitablement : au-delà des déclarations et des promesses, ce lien existe-t-il vraiment ? Il s’agit là d’un problème éminemment métaphysique puisqu’il touche au statut de ce qui est réel. En affirmant qu’« être, c’est être perçu », Berkeley exprime par avance le mot d’ordre de sociétés idéalistes qui font dépendre l’existence d’une chose de sa représentation.
Le concept de « partage » permet de préciser la nature de cet idéalisme. On sait qu’il désigne une des caractéristiques centrales des sociétés dites de l’« information ». Le partage des données, mais aussi celui des images, des liens, des textes, des vidéos, etc. ne désigne pas seulement une activité rendue possible par les outils informatiques, il figure au premier rang des impératifs de l’ère numérique. Pour paraphraser Berkeley, on pourrait dire qu’« être, c’est être partagé ». Du fait de la signification morale du mot « partage », cette exigence prend rapidement une connotation éthique positive. On insiste sur l’horizontalité des échanges virtuels, la construction en réseaux d’une réalité qui n’admet plus de hiérarchies naturelles entre le point émetteur du message et ses destinataires. Des perspectives plus critiques dénoncent, au contraire, les illusions de ce partage libre des données, en insistant surtout sur les opportunités qu’il offre en matière de surveillance. Le partage devient alors l’idole d’une société de la transparence hostile à l’intime.
Aborder le problème depuis le rapport métaphysique entre réalité et partage permet de ne pas céder trop vite au jugement normatif. Comment expliquer le désir de fixer dans une image, puis de partager sur les réseaux sociaux, des expériences qui, jusque-là, tiraient leur valeur de leur singularité ? Cette question se pose à chaque fois que l’on constate qu’un événement dont le principe est de ne pas être reproductible se trouve transformé en une représentation qu’il sera loisible de partager. C’est le cas lorsque, par exemple dans un musée, la rencontre avec une œuvre d’art est médiatisée (certains diront empêchée) par une photographie prise sur un téléphone portable[3].
De plus en plus souvent, un dispositif technique s’intercale entre le sujet percevant et l’œuvre, comme si la matérialité de cette dernière passait au second plan. Cette formulation nous replace dans la problématique de Berkeley : l’image fixée durablement dans la mémoire du téléphone portable supplée l’absence de garantie quant à la réalité matérielle de l’œuvre, et par conséquent quant à la réalité de la rencontre du spectateur avec elle. Pour s’assurer non seulement que l’œuvre existe indépendamment de son regard, mais que l’expérience esthétique a bien « eu lieu », le sujet soumet l’événement à sa représentation. Il ne faut guère plus de quelques manipulations digitales pour que l’œuvre et l’expérience ainsi représentées fassent ensuite l’objet d’un partage auprès de spectateurs absents du musée.
Envisagé de ce point de vue, le désir de « partager » émane d’un doute sur la réalité de ce qui est vécu. À l’inverse de Berkeley, nous ne disposons plus, du moins majoritairement, d’une certitude relativement à l’existence d’un Grand Spectateur dont le regard sous-tend la permanence des choses. D’où la tentation de multiplier les petits spectateurs qui attesteront que l’événement a bien eu lieu.
La plupart des images ou des scènes mises en ligne sont accompagnées d’une information chiffrée sur le nombre de « vues » dont elles font l’objet. Certains dispositifs techniques instituent même une proportionnalité exacte entre la permanence de la représentation et la quantité de regards qui se portent sur elles. C’est le cas, par exemple, de l’application Snapchat très populaire chez les adolescents. Fondée sur le partage des photographies ou des vidéos mises en ligne par les utilisateurs, elle a la particularité de limiter le temps de visualisation du média envoyé. L’une des fonctionnalités les plus appréciées de l’application consiste à augmenter le temps de visualisation en fonction du nombre de vues et de sélections de l’image par ses destinataires.
Le lien berkeleyen entre perception et permanence fonctionne ici à plein : plus une image est perçue, plus longtemps elle existe. La course contre la dématérialisation a ceci de particulier qu’elle s’effectue dans un cadre entièrement virtuel. Le plat que je m’apprête à consommer, le nouveau vêtement que je porte, mais aussi le corps que j’enlace ou le visage sur lequel je porte un baiser réclament pour continuer à exister comme représentations d’être partagés par un maximum d’utilisateurs.
Dans un dispositif où l’être est fonction du partage, l’originalité de l’image ou de la scène filmée deviennent des moyens pour augmenter leur diffusion, donc le sentiment que ce qui est vécu existe vraiment. Dès lors, l’intime ne se garantit plus seulement du lien fragile avec un autre singulier. Pour se vérifier lui-même, il réclame une extension de sa visibilité à un nombre indéfini d’autres regards. Dans l’espace virtuel des réseaux informatiques, la plupart de ces regards sont anonymes.
On peut vérifier cette hypothèse sur une dimension de l’existence que chacun s’accorde à considérer comme intime, à savoir la sexualité. Ici encore, la multiplication des sites pornographiques, surtout lorsqu’ils sont animés par des amateurs et non par des professionnels, donne lieu à une profusion de jugements de valeurs. On interprète cette monstration de soi et de son corps, soit comme une libération par rapport à la morale victorienne, soit (plus souvent) comme une dénaturation de relations qui n’auraient de sens qu’à demeurer secrètes. Mais aucun jugement de valeur ne permet de comprendre pourquoi tant d’individus prennent le risque de montrer leurs ébats sexuels gratuitement ou en échange des faibles rémunérations encore offertes par une industrie pornographique démocratisée. L’explication la plus vraisemblable est que ces individus cherchent à ramener l’événement du plaisir sexuel à sa représentation afin de s’assurer qu’il a bien eu lieu.
L’hypothèse de l’exhibitionnisme si souvent avancée pour expliquer la disparition de l’intime n’est pas concluante ici. L’exhibitionniste jouit de voir l’effet de sa transgression dans le regard de l’autre tandis que ceux qui offrent leurs ébats sexuels au réseau peuvent à peine en imaginer les conséquences. Ils n’ont aucune expérience sensible des effets de ce qu’ils montrent, ils peuvent seulement mesurer le nombre de destinataires concernés par ces effets. Dans ces conditions, il est plus vraisemblable de dire qu’il s’agit de s’assurer par le partage des images que quelque chose a bien eu lieu, puisque le fait de le vivre ne constitue plus une garantie suffisante sur ce point. Ce qui fait événement, c’est moins l’enlacement des corps et le plaisir qu’il promet que le nombre de « vues » qui porte sur lui, et atteste virtuellement que quelque chose de signifiant s’est produit[4].
De même, l’incrimination du narcissisme dans la remise en cause de l’intime doit être nuancée. Que les relations amoureuses, amicales ou sexuelles soient désormais soumises à une logique de la performance, que l’individu-roi les présente comme des trophées susceptibles d’être mis au crédit de sa valeur objective sur le marché des sentiments : ce sont là autant de thèses qui engagent une histoire à haut risque de la psychologie sociale.
Il est moins aventureux d’en rester aux représentations de l’intime, sans préjuger trop rapidement des expériences qu’elles recouvrent. Dans ce domaine, il est exact de dire qu’une société du partage fonctionne par l’émission de signes, donc qu’elle engage un système d’interprétation favorable à la mise en concurrence. Comme le nombre d’« amis » sur un réseau social, celui des « vues » accolé à une image ou à une vidéo est fonction du soin avec lequel un utilisateur met en scène sa biographie, ses sentiments ou ses désirs. Mieux il montre, ou plus il en montre, plus il a de chances d’être regardé. Il y a bien une satisfaction à constater que les monstrations de sa propre vie intime rencontrent un large public. Mais rien ne dit que cette satisfaction soit de nature narcissique (du moins dans le sens péjoratif que l’on associe généralement à ce terme). Cette satisfaction pourrait bien venir d’abord de ce que le regard des autres affaiblit le doute sur la réalité de nos expériences intimes. Surtout lorsque ce regard se traduit par l’énoncé virtuel d’un « J’aime » ou d’un « pouce bleu » approbateur. Que ce genre de signes flattent l’amour-propre du metteur en scène ou non, ils énoncent un jugement de réalité bienvenu : « Ta vie intime existe, je l’ai vue ».
Vertus et limites de la reconnaissance
L’intime est-il compatible avec les moyens mis en œuvre pour s’assurer de son existence ? Qu’une expérience intime ne se soustraie pas à tous les regards n’implique pas, en effet, qu’elle puisse, sans préjudice pour elle-même, devenir l’objet d’une visibilité totale. Non pas, on l’a vu, parce que l’intime s’identifierait au caché, mais parce que la visibilité offerte sur les réseaux sociaux participe d’une conception « idéaliste » du partage.
Dans son étude sur les « réseaux amoureux », la sociologue Eva Illouz a montré qu’Internet promeut un modèle de présentation de soi essentiellement abstrait. Celui-ci se caractérise par un processus de formalisation du corps qui commence, sur les sites de rencontre, par l’adoption obligatoire d’un pseudonyme. Ce n’est là que le premier moment d’un processus où les sujets s’envisagent les uns les autres comme des « catégories linguistiques ». La nécessité de remplir des questionnaires permet l’identification des individus à l’aide d’une série de paramètres généraux. Elle oriente aussi l’utilisateur vers des « cibles » grâce au criblage algorithmique des désirs.
Sur ces sites, l’idée de la rencontre précède la rencontre elle-même, ce qui rend sans aucun doute cette dernière plus difficile. Eva Illouz montre aussi que la forme des sites de rencontre est celle d’un marché où 1/ règne l’abondance et où 2/ le risque de la mauvaise rencontre est inversement proportionnel à la quantité d’informations réunies par l’internaute. Ces sites de rencontre mettent en œuvre un modèle de l’intersubjectivité intellectualiste de part en part. Comme chez Berkeley, la représentation précède les dimensions corporelles et matérielles de la rencontre, au point de se substituer parfois à elle.
Dans le partage informatique des informations, l’image de soi n’est pas seulement un objet de perception pour les autres, mais aussi une occasion de jugement. Ce qui, de ses désirs, de son corps ou de sa biographe est dit ou montré fait l’objet d’une évaluation. Dès lors, si la rencontre a lieu, elle se produit sur le fond des attentes créées par un jugement qui la précède. Or, une rencontre n’est un événement que si elle déjoue mes attentes en excédant mes représentations. C’est, du reste, la raison pour laquelle il est préférable d’être (au moins) deux pour établir un lien intime. Un autre parvient parfois à contredire l’idée que je me fais de l’amitié, de l’amour, du plaisir ou, par-dessus tout, il modifie l’idée que je me fais de moi-même. Or, en arrivant au rendez-vous des corps avec ses propres représentations, le sujet introduit dans l’intime une réflexivité qui lui est étrangère.
Cet autre corps qui se présente comme la promesse d’un ailleurs, le sujet de la représentation se demande en effet s’il correspond à ses attentes ou s’il sera capable de lui donner du plaisir. Mais le temps de la réflexion retarde l’événement. Souvent il l’annule, comme dans le cas si fréquent où un individu éteint son ordinateur parce qu’il désespère de trouver sur un site de rencontre l’image d’un corps correspondant en tout point à l’idée qu’il se fait d’une rencontre « réussie ».
Cette tension entre le partage intime (sensible et limité à un petit nombre de sujets) et le partage de l’intime (intellectuel et virtuellement indéfini) n’est pas seulement repérable dans le fonctionnement des sites de rencontre. Elle tend à devenir structurelle dès lors que ce qui est « authentiquement » intime fait l’objet d’un doute que seule la validation d’autres regards semble capable d’exorciser. On peut, par exemple, interpréter le développement des éthiques narratives comme un signe de ce que le désir de reconnaissance sociale s’est emparé des expériences intimes. Comme cela a été précédemment indiqué, ce désir participe de la démocratisation de l’intime : le droit de rendre compte de sa biographie et de reconstituer un ordre dans le tissu de ses expériences intimes est indissociable du libéralisme moral.
Lorsqu’un individu se revendique comme le narrateur de sa vie, c’est avant tout pour refuser d’en être le simple patient. Se raconter, c’est tout d’abord refuser de soumettre sa vie et ses désirs aux récits dominants portant sur ce qu’est une vie « réussie ». Selon Paul Ricœur, la psychanalyse participe par exemple d’une reconquête de soi par la production d’une histoire en première personne. « En quête de narrateur », le sujet élabore des récits destinés à assurer à sa propre vie une cohérence que le seul fait de la vivre ne lui garantit pas.
La tension entre le récit intime et son objet ressurgit lorsque le droit à se raconter se transforme en injonction. À la suite de Hannah Arendt, Judith Butler introduit une distinction entre être le « narrateur » de sa vie et en être l’« auteur ». Le fait qu’il se raconte n’implique pas que le sujet maîtrise, comme un auteur de fiction, tous les fils de l’histoire, de son début à son dénouement. Butler rappelle qu’une vie excède les comptes rendus qui peuvent en être proposés, précisément parce qu’il existe des normes de la narration acceptable qui émanent de la société plus que du sujet lui-même. Lorsqu’elles exigent une cohérence absolue, ces normes nient la contingence des événements qui tissent l’intime : « il se pourrait que le fait d’avoir une origine signifie avoir plusieurs versions possibles de cette origine[5] ». Dès lors qu’elle devient l’unique critère de l’intelligibilité d’une vie, la transparence à soi plaque sur l’intime une exigence que celui-ci ne peut jamais remplir : celle d’être à tout moment l’auteur unique de ses actes et le maître de ses désirs.
Parmi les sciences qui traitent de l’intime, la psychanalyse fait aujourd’hui l’objet d’un soupçon, précisément parce qu’elle fait droit à cette opacité structurelle qui contrevient au désir d’être pleinement reconnu. À juste titre, Butler pointe un déni de l’inconscient dans l’injonction à raconter sa vie d’une manière parfaitement cohérente. En effet, « comprendre l’inconscient, c’est comprendre ce qui ne peut pas, à proprement parler m’appartenir, parce qu’il défie précisément la rhétorique de l’appartenance, parce qu’il est une façon d’être dépossédé de soi, depuis le début, par l’interpellation de l’autre[6] ». L’intime tel qu’il a été défini plus haut, c’est-à-dire comme un concept relationnel, s’excepte de cette « rhétorique de l’appartenance ». Si les désirs intimes sont partiellement inconscients, c’est qu’il y a un fonds d’inénarrable dans toute vie. L’unique histoire que le sujet ne peut raconter est l’histoire de sa propre émergence comme sujet. C’est précisément pour en faire le récit qu’il a besoin du concours de ses proches.
À l’instar d’un secret, l’intime n’a de signification que s’il est partagé. En ce sens, le récit de soi entre de plein droit dans le colloque intime qu’un sujet élabore avec ceux qu’il a élus, et auxquels il accorde le droit de devenir des personnages de sa vie. Mais, toujours comme un secret, l’intime perd sa vocation si les normes de ce partage sont dictées par la société et si l’adéquation à ces normes est sanctionnée par des regards anonymes. Envisagé comme un gage de sa propre réalité (« je me raconte, donc je suis »), le partage de l’intime suppose que celui qui fait le récit de sa vie maîtrise parfaitement sa narration ou que celui qui se montre dispose déjà d’une image conforme à ce qu’il est. Or, les relations intimes déjouent les récits les plus cohérents et modifient les images de soi les plus stables.
À cet égard, elles sont un démenti au fantasme selon lequel un sujet disposerait d’un savoir définitif sur sa propre identité. En confondant le récit de soi avec un simple partage d’informations, on réduit à rien une « éthique fondée sur notre partiel aveuglement à nous-mêmes[7] ». Qu’on le nomme « inconscient » ou pas, cet aveuglement partiel est une condition de l’intime. Pourquoi s’abandonnerait-on à la parole ou au corps d’un proche, sinon parce que l’histoire de notre vie reste à écrire par d’autres ?
Le fonctionnement des sites de rencontres et l’injonction contemporaine à faire récit de sa vie ne sont que des exemples parmi d’autres du devenir contemporain de l’intime. Le thème du « partage » permet d’aborder ce devenir en tenant compte à la fois du désir de reconnaissance qui s’applique désormais aux expériences autrefois considérées comme « privées » et des difficultés qui naissent de cette application. Il est dans la nature d’une expérience intime d’être partagée, que ce soit par l’échange des regards, celui des paroles dans la conversation ou l’entrelacement des corps. Ce partage n’entre en tension avec l’intime que lorsque son objet prend la forme d’une représentation claire et distincte destinée à être interprétée par tous. Ce n’est plus alors l’intime qui est partagé, mais une information qui porte sur lui, et dont l’objectif est de garantir la réalité de ce qu’elle diffuse.
Cette tension est devenue structurelle dans des sociétés marquées par ce que Walter Benjamin appelait la « pauvreté en expérience ». Cette expression désigne le doute relatif au sens de ce qui est vécu et fait par un sujet singulier, mais dans un contexte de plus en plus médiatisé par les objets techniques. Une expérience peut être dite « pauvre » lorsque la réponse à la question « qui ? » (qui agit ?, qui désire ?, qui aime ?, etc.) perd de son évidence[8]. Concernant les liens intimes, cette perte d’évidence est devenue structurelle. Faute de grand Spectateur universel interior intimo meo et susceptible de sonder les cœurs, les expériences amoureuses, amicales et désirantes sont soumises à une forme de « pauvreté » à laquelle il est tentant de répliquer par l’émission inflationniste de signes.
Comme dans le domaine économique (pour une fois comparable avec celui de l’intime), cette inflation peut apaiser les situations de crise, mais elle ne suffit pas à vaincre le doute sur la valeur de ce qui est échangé avec autant de largesses. Hors de toute garantie théologique, il n’existe ni lieu ni procédure qui abolisse le doute sur la réalité de l’intime. Sa fragilité se rejoue à chaque fois qu’un individu prend le risque d’engager son identité dans un lien sensible dont la réciprocité et la permanence ne sont garanties nulle part.
Cet article a été publié pour la première fois le 11 octobre 2019 dans AOC à l’occasion du 29e Salon de la Revue. Nous avons publié en complicité cet article qui est paru le 14 novembre dans le n°6 de la très belle revue Sensibilités, « Les Paradoxes de l’intime », coordonné par Arlette Farge et Clémentine Vidal-Naquet.
