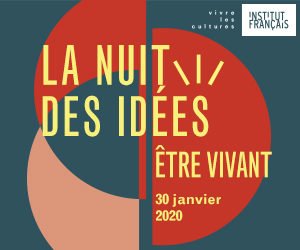Le management, une modernité nazie
« Par cette union systématique de la science et de l’application,
l’Occident réalise là où l’Orient demeure en retard »
André Siegfried[1]
Le 2 octobre 1941, au moment où il prend officiellement ses fonctions de « Protecteur du Reich » pour la Bohème-Moravie, Reinhard Heydrich, chef de l’Office central de la sécurité du Reich, de la Police de Sécurité et du Service de Renseignement de la SS (Sipo-SD), tient un discours empreint d’inquiétude. Les temps sont exaltants et les succès éclatants, dit-il en substance, au moment où la guerre à l’Est est pratiquement gagnée. L’opération Barbarossa est une réussite gigantesque, une guerre-éclair dans les règles de l’art, après les victoires sans conteste remportées en Pologne, puis à l’Ouest et dans les Balkans. Rien ne peut s’opposer à la puissance des armes allemandes, et aucun obstacle sérieux ne peut entraver l’extension du Reich scandée par les trois temps de la victoire, de la conquête et de la colonisation ou, selon les territoires considérés, l’occupation/vassalisation.
Les succès sont tels que les problèmes n’en sont pourtant que plus grands. Dans le cas de la Bohème-Moravie, le numéro 2 de la SS s’inquiète de l’hostilité des Tchèques, voire de l’émergence d’un mouvement de résistance sérieux. Il faut y veiller, car c’est souvent de cette région, pourtant fécondée par le génie germanique, que partent les « coups de poignard » contre l’Allemagne – que l’on songe, dit Heydrich, à la défenestration de Prague (1618) ou bien, dès le 1er siècle de notre ère, aux menées de Marobod[2] contre Hermann le Chérusque.
Heydrich est là pour « prendre le problème à bras-le-corps » (hart zupacken), ce qu’il va faire, annonce-t-il, avec son sérieux, sa méticulosité et sa dureté habituelles. Le chef de la Sipo-SD ne veut rien laisser au hasard. Les problèmes de sécurité posés par le territoire tchèque, transcendent largement la seule dimension policière. Le travail de police requiert une « plongée empathique et intellectue