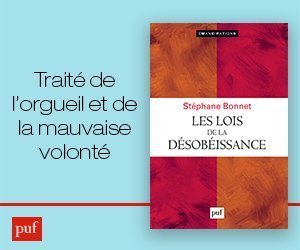Le sens de la structure inégalitaire des sociétés
Revenu, logement, alimentation, santé, loisirs, pratiques culturelles, langagières, éducatives, sont autant de domaines ou de dimensions de la vie sociale où se constatent des inégalités spécifiques, notamment de classe et de genre. Ces réalités sont pourtant assez systématiquement déniées ou déréalisées dans le monde social par toutes celles et ceux qui ont intérêt, consciemment ou inconsciemment, à ne pas les voir. Quand on admet l’existence des inégalités, ce qui est loin d’être toujours le cas, on en parle comme si elles n’avaient au fond aucune espèce de conséquence sur ceux qui les vivent.
Certains en effet ne veulent voir que des différences ou de la diversité et jamais d’inégalités ou de dominations. Ils remettent en cause la vision « caricaturale » du monde social que les chercheurs sont accusés de produire, doutent de l’existence des déterminismes sociaux comme on doutait des lois de la nature du temps de Kepler, et s’agacent devant le prétendu fatalisme sociologique censé décourager les « initiatives » ou les « bonnes volontés » et empêcher les parcours de réussite. Et pendant ce temps-là, les inégalités se reproduisent quotidiennement dans un silence étourdissant. La méconnaissance des inégalités participe pleinement à leur reproduction.
Dans un récent ouvrage portant sur les inégalités de classe vues à hauteur d’enfants âgés de 5 à 6 ans[1], un collectif de dix-sept sociologues a voulu mettre au jour les effets cumulés des inégalités de toutes sortes, des plus matérielles aux plus culturelles. Ces réalités sont bien connues dans le monde de la recherche, même si les chercheurs n’ont pas toujours une conscience très claire des effets puissamment structurants que produisent ces inégalités dans toutes les parties du monde social et sur tous les objets scientifiquement étudiés.
Relativisme et inégalités
Mais un certain relativisme s’est emparé des chercheurs en sciences sociales qui ont une vision trop souvent artificialiste des questions d’inéga