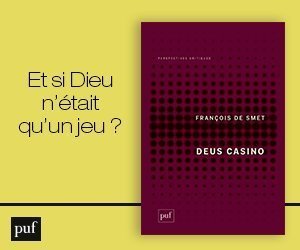À quoi sert l’archéologie ?
À quoi sert l’archéologie ? Question futile, a priori ! Pour certains, elle ne sert qu’à garnir les vitrines des musées, à alimenter les voyages et croisières exotiques organisés pour l’occupation du troisième âge, ou encore à faire rêver les (petits) enfants, bref, elle relèverait surtout de la distraction, futile elle aussi. Pour les historiens, ce fut longtemps une discipline accessoire, « une science auxiliaire de l’histoire », disait-on encore jusqu’au milieu du XXe siècle : la vérité était dans les textes anciens, et les archéologues ne faisaient que sortir de terre des vestiges plus ou moins bien conservés et destinés à en illustrer les récits.
Enfin, pour les aménageurs économiques et les élus locaux qui les finançaient, elle fut longtemps, et parfois encore, une empêcheuse de bétonner en rond : « Vous vous occupez des morts, moi, je m’occupe des vivants », ai-je parfois entendu, quand je présidais l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), dans la bouche d’hommes politiques sincères mais peut-être un peu limités dans leur vision du monde. La réponse courtoise était alors de leur faire remarquer avec diplomatie qu’ils n’étaient pas voués, hélas, à demeurer toujours vivants, mais qu’en attendant, ils étaient en train de détruire en toute bonne foi, et définitivement, le patrimoine archéologique de tous les futurs vivants à venir.
La dernière offensive d’envergure ne date d’ailleurs que de 2014, lorsque parmi les mesures d’un « choc de simplification » administrative annoncé par le président de la République, il était proposé, sous la pression intéressée des lobbys du BTP et autres sociétés d’autoroutes, de limiter la recherche de sites archéologiques, préalablement à tout terrassement d’envergure, à de simples prospections électromagnétiques de surface, dites « non-destructives », au lieu des tranchées à la pelleteuse qui sont la méthode usuelle des sondages archéologiques.
Techniques « non-destructives » certes bien util