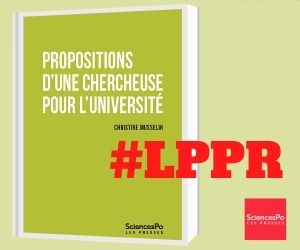Reconnaissance faciale : envisager le portrait
La France expérimente différents systèmes de reconnaissance faciale. Elle est le premier pays d’Europe à s’y intéresser d’aussi près. Outre le million et demi de caméras de surveillance « classiques » déjà installées sur l’ensemble du territoire français, certaines municipalités enregistrent les visages et comportements pour alimenter et interroger une base de données.
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a désormais recours à une application de reconnaissance faciale pour certaines démarches administratives. Alors que la surveillance avance à bas bruit dans l’espace public, on se trouve de plus en plus confrontés à un pouvoir sans visage, à l’absence d’interlocuteurs identifiables dans de nombreux rapports sociaux et économiques. Entre contrôle des visages d’un côté et absence de visage de l’autre, des questions éthiques se posent : qu’est-ce qu’un visage dit de la personne qui le porte ? Qu’est-ce qu’il engage dans la relation à l’autre ?
Le sujet de la reconnaissance faciale est dans le débat public, plusieurs articles sont parus fin 2019[1]. Ils font état des expérimentations en cours et des batailles judiciaires engagées par la société civile à l’encontre de municipalités qui en ont pris l’initiative. Tous ces articles pointent l’urgence d’une réflexion à mener si nous voulons que l’humain reste décisionnaire des innovations technologiques et de leurs conséquences dans nos vies. On peut effectivement craindre que la pression des industriels et de la demande sécuritaire nourrie par quelques pouvoirs politiques fassent vaciller le socle de certaines valeurs démocratiques.
On pourrait se croire à l’abri des façons de procéder en Chine, pays vers lequel les regards se tournent lorsqu’il s’agit de reconnaissance faciale. Alors qu’en Occident, on essaierait de fixer un cadre juridique en amont des innovations technologiques, les Chinois feraient l’inverse : le gouvernement inciterait entrepreneurs et chercheurs à innover, quitte à réguler a posteriori