En Tunisie, un gouvernement pour l’Histoire
Le miroir de l’actualité est parfois trompeur. Il dit trop peu des processus de fond qui irriguent une région, un peuple, une génération, un monde. Chine, Syrie, Iran, Arabie saoudite, États-Unis, Chili, Algérie… En 2020, l’actualité internationale occupe le devant de la scène médiatique. La Tunisie, elle, passe désormais au second plan. Et pourtant, ce pays de 12 millions d’habitants vient de passer une étape majeure dans un processus politique qui fait figure d’exception.
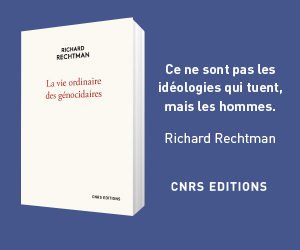
Anodine en apparence face aux grands bouleversements que connaît le Moyen-Orient, la formation du gouvernement tunisien marque une nouvelle étape des transformations politiques et sociales profondes qui permettent à ce pays, sinon de forger une méthode, du moins de trouver son chemin entre les écueils nombreux qui rythment sa quête démocratique. Fruit d’un long compromis de quatre mois et de luttes intenses entre les partis – et notamment entre Ennahdha, musulman conservateur, 52 députés sur 217, et le président Kaïs Saïed, élu à 72,71 % des suffrages –, construit sous la menace d’une nouvelle sanction électorale des Tunisiens, cet exécutif-là peut tout changer.
La formation de ce gouvernement est le premier acte transpartisan d’une classe politique qui a beaucoup déçu les Tunisiens.
À y regarder de près, la formation de ce gouvernement est le premier acte transpartisan d’une classe politique qui a beaucoup déçu les Tunisiens depuis le vote de la constitution en janvier 2014. S’il parvient à se maintenir dans la durée et à établir un calendrier de réforme clair, ce nouvel exécutif est donc porteur d’espoir, de renouveau et de changement, quatre mois après la tenue de l’élection législative du 6 octobre 2019.
Le pire a été évité in extremis : le 19 février, quelques heures avant l’expiration du délais d’un mois dont il disposait pour former son cabinet, le premier ministre Elyes Fakhfakh (ex-membre du parti socialiste Ettakatol) a d’abord annoncé son gouvernement. Un temps contesté du f
