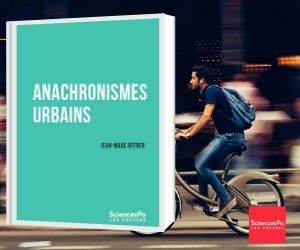Bien manger, bien respirer : les futures municipalités seront-elles prêtes à payer ?
L’heure tourne avant le premier tour des municipales et les candidats dévoilent petit à petit et partout sur les territoires les principales mesures de leurs programmes. Les équipes sortantes qui visent la reconquête de leurs fauteuils ont sans aucun doute eu en tête, au moment de concevoir ces programmes, les résultats de l’enquête conduite par le CEVIPOF de Sciences Po à l’initiative de l’Association des Maires de France sur les attentes des citoyens vis-à-vis de leurs maires, publiés en juillet dernier.
Les habitants expriment dans cette enquête deux priorités devant guider à leurs yeux l’action publique municipale : la préservation de l’environnement et le développement ou le maintien des services de proximité (la hiérarchisation entre les deux dépendant de la taille des communes). On retrouve en effet, en analysant les promesses de campagne des prétendant·e·s de tous bords politiques à la tête des métropoles et des villes de taille moyenne, des engagements en faveur du développement des mobilités douces, de la végétalisation des zones urbaines et de la vitalité des centres-villes (alors que leur délaissement avait contribué, en 2014, à plusieurs des victoires de l’extrême droite).
L’attachement à la préservation de l’environnement et aux services de proximité exprimé par les citoyens dans le cadre de l’enquête du CEVIPOF traduit sous forme de priorités de politiques municipales une réalité dont les édiles ont pleinement conscience : on apprécie une ville pour son cadre de vie et la qualité de vie qu’elle offre. La presse ne manque d’ailleurs pas de proposer régulièrement des unes dédiées à des classements des villes où il fait bon vivre.
Les nouvelles équipes municipales devront à ce titre se poser, dès le printemps 2020, une question : s’agissant de la qualité de vie des habitants des villes dont elles viendront de prendre la tête, où débute et où se termine le champ de leur action ? Il ne s’agit pas ici d’une problématique de répartition des compét