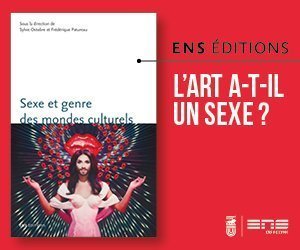Le patient zéro est toujours innocent
Le terme « cas index » est utilisé en génétique et en infectiologie pour désigner, soit le premier patient chez lequel a été identifié le gène responsable d’une maladie génétique, soit le premier malade contaminé par une nouvelle souche virale ou un nouveau virus. Le terme de « patient zéro », utilisé exclusivement en infectiologie, est apparu aux débuts du SIDA, lorsque l’identification du virus a permis de remonter jusqu’au premier malade diagnostiqué aux États-Unis en 1980. Ce jeune stewart canadien du nom de Gaëtan Dugas avait à lui seul, par ses pratiques homosexuelles non protégées, contaminé environ un quart de tous les cas diagnostiqués avant 1983. Ce patient est devenu tristement célèbre, il a été diabolisé sous le sobriquet de « super spreader » (super propagateur), son sarcome de Kaposi a été surnommé le « Gay cancer », déclenchant une grande vague d’homophobie.
Nos pays occidentaux connaissaient alors une période de sérénité infectieuse inédite dans toute l’histoire de l’humanité. Depuis la fin des grandes épidémies intercontinentales, après l’hygiénisme administratif, avec les vaccinations et les antibiotiques, on s’était surpris à rêver à l’immortalité. Le SIDA a eu l’effet d’un coup de tonnerre dans un ciel serein et il a ravivé les grandes peurs ancestrales.
Arrivé concomitamment aux grands progrès du décodage génétique, le SIDA a permis de libérer des fonds considérables pour améliorer l’identification des virus et la recherche d’antiviraux. Ainsi, à chaque apparition de nouvelle souche virale, il est devenu plus facile d’en décoder le génome et d’en observer les mutations. Si ce virus provoque une maladie à transmission interhumaine, les épidémiologistes et les virologues peuvent ainsi remonter assez facilement jusqu’au patient zéro de cette maladie émergente.
Deux raisons ont probablement contribué à préférer le terme de « patient zéro » à celui de « patient un ». D’une part, la place hors numérotation de ce zéro souligne son caractère