Pourquoi demander pourquoi ?
On est cheminot, enseignant, interne. On participe à un dîner quelconque, quelque part, et quelqu’un demande : « Mais pourquoi donc fais-tu grève ? » On répond que ce projet que le gouvernement veut nous imposer est injuste, et un autre interlocuteur reprend : « Mais pourquoi n’est-il pas juste ? Pourquoi ne devrait-on pas avoir un système égal pour tous, comme ils disent ? » Et on parle pénibilité, espérance de vie, équité, etc.
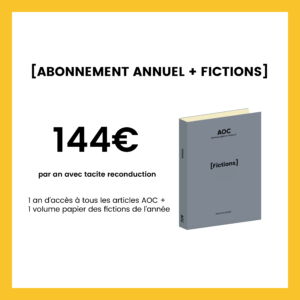
Ce petit mot, « pourquoi ? » ponctue nos discussions – combien de fois par jour l’employons nous ? Loin d’être restreint à la politique, il traverse tous les champs, du plus quotidien – « pourquoi le boulanger est-il fermé aujourd’hui ? » – au plus manifestement métaphysique – « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? », demandait Leibniz – en passant par l’intime – « pourquoi il/elle n’est pas venu ? » Il est la question du savant – « pourquoi le bâton droit plongé dans l’eau m’apparaît-il plié ? » – comme celle des détectives – « pourquoi le majordome a-t-il mis ses gants un dimanche ? »
Parmi toutes les questions qui nous permettent de nous orienter dans le monde et dans nos vies communes – qui ?, quoi ?, combien ? , où ?, quand ? – celle-ci semble nécessaire pour qu’un certain sens advienne, quel que soit la signification qu’on donne à ce mot. De fait, à la différence de ces autres questions, il a vertu de lier ce qui existe à autre chose : les opinions à leurs justifications, les actions à leurs motifs, les événements à leurs effets. Imaginons un instant ce que serait un monde ou une existence sans possibilité de demander « pourquoi ? », sans réponse imaginable ou disponible à cette question : un amas de faits hétéroclites, des actions incompréhensibles, des opinions aléatoires à avoir ou ne pas avoir. Notre expert en bâtons ou en optique serait au chômage ; la vie courante en pâtirait tout autant : en sachant ou en imaginant pourquoi nos amis ou collègues font telles et telles choses, nous pouvons en effet prédire leur comp
